«Aleksandra» de Lisa Weeda: quand les petites gens sont le jouet de la grande politique
Ces dernières semaines, Lisa Weeda a fait son apparition dans les médias néerlandais en tant qu’experte de la guerre en Ukraine. Ces invitations font suite à la parution de son excellent premier roman, Aleksandra, qui raconte l’histoire d’une famille cosaque déchirée.

© Geert Snoeijen
Si Lisa Weeda s’exprime désormais souvent en tant qu’experte de l’Ukraine dans les médias néerlandais, c’est bien sûr suite à la parution d’Aleksandra, son excellent premier roman qui raconte l’histoire d’une famille cosaque déchirée.
Alors que l’Ukraine se retrouve sous le feu des projecteurs pour les raisons dramatiques que l’on sait, le premier roman de Lisa Weeda, Aleksandra, semble entamer une seconde vie. Le livre figure en outre parmi les finalistes du prix littéraire Libris. Et c’est mérité, car Aleksandra est un véritable tour de force, un imposant roman aux couches multiples, truffé de petite et de grande histoire, écrit dans une langue pleine de fantaisie qui vous promène entre le passé et le présent, entre La Haye, Moscou, Kiev, Odessa et Lougansk, de la table de cuisine au champ de bataille et inversement.
Nous faisons la connaissance de Lisa, la narratrice, en août 2018, à un poste frontière entre l’Ukraine et la République populaire de Lougansk, l’une des deux républiques populaires situées tout à l’est de l’Ukraine, qui ont fait sécession en 2014 et ne sont reconnues que par la Russie. Lisa tente de convaincre un soldat de la laisser passer, en vain. Forte d’une mission confiée par sa grand-mère Aleksandra, elle insiste. C’est qu’elle doit apporter à Kolja un mouchoir bien particulier, sur lequel l’arbre généalogique de la famille est brodé au fil noir et rouge. Kolja est l’oncle de Lisa, probablement mort en 2015 pendant la guerre d’indépendance de Lougansk; c’est donc plutôt sa tombe qu’elle vient chercher. Sa grand-mère Aleksandra, âgée de 94 ans, a quant à elle été déportée de Lougansk par les nazis en 1942, alors que la ville s’appelait encore Vorshylovhrad.
Le soldat à la frontière est inflexible, même lorsque Lisa invoque leur haine commune du nazisme. Mais lorsqu’une personne pose malencontreusement le pied sur une mine dans un champ, elle profite de la confusion générale pour forcer la traversée. Elle est aidée par un vieil homme sympathique, mais trébuche et fait une mauvaise chute.
Lorsqu’elle se réveille, au chapitre suivant, elle se trouve dans le «Palais des Cosaques perdus», un lieu imaginaire qui ressemble étrangement au Palais des Soviets que Staline voulait faire construire à Moscou sur le site de la cathédrale du Christ-Sauveur détruite. Ce projet mégalomane ne vit jamais le jour; après la Seconde Guerre mondiale, les fondations furent utilisées comme gigantesque piscine en plein air.
 La Palais des Soviets n'a jamais été construit.
La Palais des Soviets n'a jamais été construit.© Ilya Illusenko / Wikimedia Commons
Dans ce Palais, Lisa retrouve son arrière-grand-père Nikolaï, le père de sa grand-mère Aleksandra. Ils conversent tout en déambulant dans l’immense complexe, regardant les œuvres d’art du réalisme social pleines de symboliques, débouchent sur des salles d’interrogatoire et finalement même sur la piscine. Les chapitres qui se déroulent dans le palais sont empreints de réalisme magique, une référence claire à la littérature ukrainienne d’écrivains tels que Nicolas Gogol, qui écrivait en russe mais était d’origine ukrainienne. Les chapitres se déroulant à Lougansk durant la guerre de 2014 et après alternent avec les chapitres se déroulant au Palais.
Ce Palais et la rencontre de son arrière-grand-père sont une fantastique trouvaille de Lisa Weeda pour conter l’histoire impressionnante de sa famille. Cette famille descend des Cosaques, un ancien peuple nomade qui parcourait la steppe et reçut des privilèges du tsar en échange de services mercenaires dans son armée. Au fil du temps, certains Cosaques s’installèrent comme fermiers en Ukraine, où ils cultivèrent principalement du blé.
Ainsi découvrons-nous l’histoire de la famille Temnikov, qui est aussi l’histoire de l’Ukraine. Une histoire poignante. La famille est à présent déchirée par la guerre dans le Donbass, la région orientale frontalière de la Russie; ses membres sont séparés ou disparaissent, mais il n’en a en réalité jamais été autrement. Victimes typiques de la grande politique, les petites gens sont de tout temps le jouet des aspirations géopolitiques de dictateurs tels que Hitler, Staline ou Poutine.
Lisa elle-même est le produit partiel de ces grands événements. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, sa grand-mère Aleksandra s’est en effet retrouvée aux Pays-Bas, elle que les nazis avaient mise, adolescente, en 1942, dans un train de marchandises à destination de l’Allemagne pour travailler dans une usine appartenant à IG Farben, le géant chimique qui produisait le Zyklon B utilisé pour gazer les Juifs pendant l’Holocauste.
Par le biais de l’histoire singulière d’une famille, le roman donne à connaître l’histoire de tout un pays
La scène dans laquelle Nikolaï dit adieu à sa fille sur le quai de gare est à la fois horriblement dure et pleine d’amour. Sans tomber dans le pathos, Lisa Weeda révèle ce que la guerre impose aux familles, aux petites gens. La dictature stalinienne et les brutalités infligées à la population ukrainienne dans les années 1930 prennent également un tour très concret à travers l’histoire de la famille. Le passage dans lequel la jeune Aleksandra doit choisir lequel des deux chevaux de la famille peut rester à la ferme, et lequel est donc obligé de partir pour le kolkhoze, l’une de ces fermes collectives d’État créées par Staline, laisse longtemps son empreinte.
Chaque anecdote est lourde de symboles. Nous apprenons l’existence des cerfs cosaques, toujours blessés, le corps transpercé d’une flèche, annonciateurs de la mort. Ces cerfs surgissent à tout bout de champ dans l’histoire. Et nous apprenons la signification des lignes rouges et noires sur le mouchoir brodé de la grand-mère de Lisa.
Avec Aleksandra, Lisa Weeda n’a pas seulement écrit un roman familial passionnant. C’est un livre qui, par le biais de l’histoire singulière d’une famille, donne à connaître l’histoire de tout un pays. Elle le fait dans un style fluide, sans forcer ni romancer la violence de la guerre, sans dramatiser les éléments familiaux, mais avec une couche de réalisme magique qui transforme le livre en une sorte de rêve fiévreux.
Lisa Weeda, Aleksandra, De Bezige Bij, Amsterdam, 2021. Le roman paraîtra en français, dans la traduction d’Emmanuelle Tardif, aux éditions Le Bruit du monde en janvier 2023.
Dans le Palais des Cosaques perdus
De larges gradins de marbre s’étendent à ma droite et à ma gauche. Je me relève, puis grimpe les marches aussi vite que possible. Elles sont tellement hautes qu’il me faut bondir de l’une à l’autre. Lorsque j’atteins, hors d’haleine, un perron monumental, je vois se dresser devant moi un immense édifice. Comme une pièce montée hystérique, une version plus élancée de la tour de Babel. L’ensemble se compose de six grands étages circulaires. Au sommet, une statue de Lénine. Chaque étage est entouré de colonnes que surmontent d’autres statues, des personnages faisant cinq fois ma taille. Ils agitent des drapeaux et avancent avec résolution, j’aperçois des ouvriers, des enfants, de jeunes kolkhoziennes, des garçons brandissant burins et marteaux. Ils portent des blouses et pantalons de travail, des salopettes, des tabliers, des fichus, des casquettes. Lénine, qui fait à lui seul près de deux étages, pointe son index vers le lointain, en direction du check-point ukrainien, du côté de l’Occident, à l’opposé de la zone de guerre, de la frontière avec la Russie. Je suis le prolongement de son doigt et découvre le casque du soldat qui bouge à la lisière du champ de blé. Il est encore à mes trousses, celui-là? Sous le péristyle du premier étage, une porte à glissière s’ouvre dans un bruit de craquements.
«Hé, me souffle une voix, ne reste donc pas là comme une empotée!»
Un visage apparaît par l’entrebâillement. Je reconnais le portrait en noir et blanc qui trône au-dessus du lit de ma grand-mère.
«Ça alors… Nikolaï!»
Il n’a pas vieilli d’une journée par rapport à la photo: deux ou trois sillons en travers du front, pattes d’oies au coin des yeux, moustache soignée, sourcils charbonneux et mâchoire taillée à la serpe. De sa main fine, il me fait signe d’approcher. Je jette un dernier coup d’œil à Lénine.
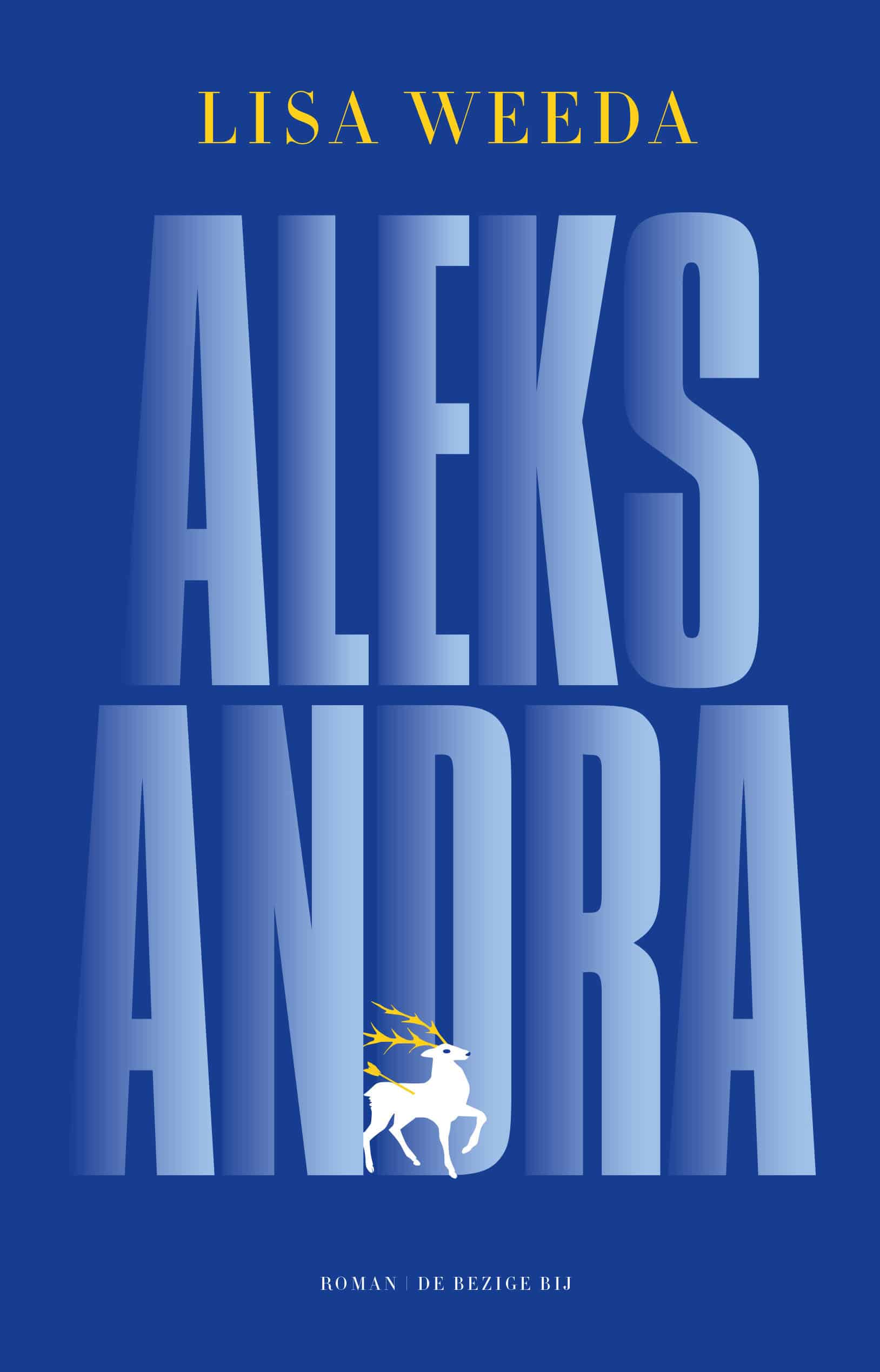
«Qu’est-ce qu’il fait ici, lui? Il a au moins cent ans de retard, non?
– Aucune importance, me répond Nikolaï avec brusquerie, viens vite à l’intérieur!»
J’escalade encore une volée de marches et file sur le marbre luisant de la terrasse en direction de la porte, par où se déversent des grains de blé.
«Il faudra rentrer tout ça», dit-il d’un ton soucieux.
Je m’agenouille devant la porte. Dans le creux de mes paumes réunies en coupelle, je transporte précautionneusement les grains à l’intérieur.
«Plus vite, mon enfant, aussi vite que tes jeunes bras le permettent!»
Tandis que je me sers de mes mains comme d’un chasse-neige, repoussant le blé pour le mettre à l’abri, le soldat me crie que je suis au milieu d’un champ de mines et que je ne dois surtout pas bouger.
«Je vois mal ce que tu es en train de faire, mais écoute-moi et reste où tu es! Plus. Un. Geste!»
J’hésite un instant, ne sachant pas si je dois entrer dans la tour ou juste fermer les yeux et, comme le dit le soldat, rester immobile jusqu’à ce qu’on vienne me chercher, mais le regard bleu, bienveillant, de mon arrière-grand-père et les bruits de pas qui se rapprochent derrière moi me convainquent de rentrer les derniers grains et de me faufiler par l’entrebâillement. Une fois à l’intérieur, j’aide Nikolaï à refermer la lourde porte en bois. Il plie les genoux et, penché vers l’avant, expire profondément. Quant à moi, après m’être débarrassée de mon sac à dos, je me laisse choir dans le blé. La voûte et les murs de la salle sont couverts de fresques: une foule marchant sous les drapeaux rouges, des enfants tout de blanc vêtus, à l’exception d’un foulard rouge noué autour de leur cou. Il défilent sur des boulevards aussi larges que l’artère à six voies qui traverse Kyiv et où ont lieu les parades militaires du 9 mai. Marteaux et faucilles ornent les angles du plafond, je vois des étoiles rouges, des corniches dorées, des étendards de pierre. Nikolaï me tend la main et m’aide à me relever.
«Enfin tu es là, dit-il, après tout ce temps…»






