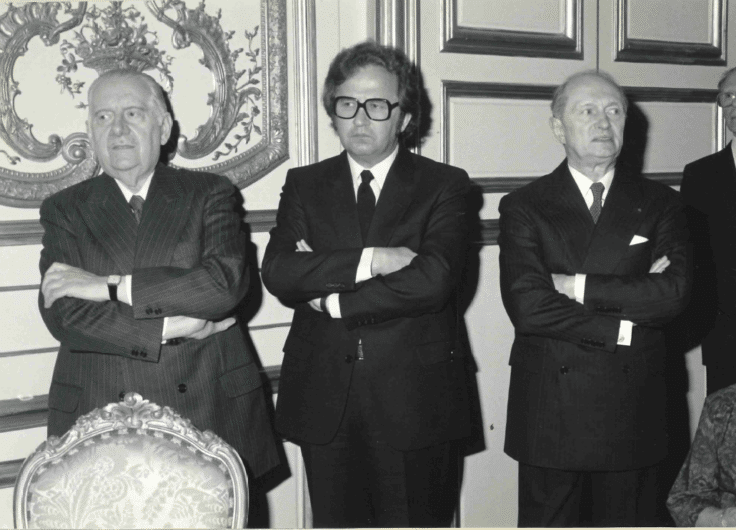Comment se rapprocher entre francophones et néerlandophones?
Hendrik Tratsaert, rédacteur en chef de Septentrion, se demande comment resserrer les liens entre les francophones et les néerlandophones. Il examine les instruments institutionnels, décrit les évolutions en cours dans les pays concernés, et tire de ces considérations une conclusion surprenante, en forme de plaidoyer.
Dans un numéro thématique consacré aux Échanges, il est impossible de ne pas se demander comment les espaces francophone et néerlandophone peuvent se rapprocher. Que doit-on faire pour favoriser le franchissement de cette frontière physique et mentale? Comme son titre le laisse pressentir, le présent article ne se contentera pas de dresser une liste de recommandations politico-administratives ou d’accords dans la même veine.

Même sans se bercer d’illusions, il demeure légitime d’inciter ses compatriotes à montrer plus d’intérêt pour leurs voisins proches et pour les régions frontalières. Parce que c’est logique, tout simplement. Parce que nous vivons à côté les uns des autres et parce que nous sommes devenus mobiles: physiquement du fait du raccourcissement des distances par le TGV, mais aussi virtuellement grâce aux commodités des autoroutes numériques. Les excuses pour ne pas se rapprocher sont devenues si peu crédibles qu’elles ont de quoi faire rougir. Dans l’ensemble formé par la Belgique, la France et les Pays-Bas vivent en effet 71 millions de francophones et 23 millions de néerlandophones (sans compter les habitants des territoires d’outre-mer des deux derniers pays), une population répartie entre trois États-nations et, dans le cas de la Belgique, deux aires linguistiques.
Tant qu’à entretenir des relations, ces trois pays ont tout intérêt à ce que celles-ci soient «de bon voisinage». Elles ont constamment évolué au fil des générations. Un long chemin a été parcouru pour favoriser le rapprochement linguistique et culturel dans ces territoires. Un facteur joue un rôle primordial face à la circulation des biens et des personnes: l’intérêt pour la langue et la culture de l’autre. Aujourd’hui comme hier, les moyens et instruments à mettre en œuvre pour le susciter sont l’enseignement des langues, les centres de connaissance et les accords bilatéraux entre et au sein des trois pays concernés pour développer les échanges directs.
Ce chemin n’a pas toujours suivi une ligne droite, ni nécessairement une courbe ascendante. Plusieurs des articles contenus dans ce numéro en témoignent. Dans toutes les situations d’échange, il faut tenir compte d’une dimension quasi insaisissable, imperméable aux interventions des États et directement conditionnée par les contacts entre personnes: la mentalité. La façon dont sont perçus les pays et leurs langues a beau être immatérielle, elle n’en détermine pas moins le niveau de curiosité qu’ils suscitent chez les étrangers. La mentalité d’un groupe, ayant toujours beaucoup à voir avec le contexte culturel et économique ainsi qu’avec l’image de soi qui en découle, peut se transformer. La mentalité a son siège entre les deux oreilles. Je veux donc croire qu’elle peut évoluer indépendamment des décisions politiques et des perceptions relayées par les médias.
Dans les lignes qui suivent, laissant les clichés nationaux de côté, je décrirai brièvement la situation de chaque pays en matière de connaissance linguistique et d’échanges culturels, puis j’exposerai mon point de vue.
Ici la France
Qui dit échanges culturels, dit réciprocité. En ce domaine, la France n’a jamais vraiment été tête de classe. Les Français que je connais de par ma profession s’intéressent tous à la culture de langue néerlandaise, mais ils sont l’exception qui confirme la règle. La Flandre et les Pays-Bas sont peu connus et n’intéressent guère, si ce n’est pour ressortir les clichés trop faciles, eux aussi en évolution, des «p’tits Belges» ou des «Pays-Bas, État modèle». Le flux d’informations en provenance des Plats Pays n’a pourtant pas tari, même s’il s’est beaucoup anglicisé. La revue Septentrion, qui fête son cinquantenaire, et le jeune site web www.les-plats-pays.com constituent de modestes, mais courageuses exceptions dans un paysage linguistique de plus en plus unilingue.
Qui dit échanges culturels, dit réciprocité. En ce domaine, la France n’a jamais vraiment été tête de classe.
Il faut se résoudre à ce que les grands pays européens aient des priorités différentes de celles des pays plus petits, surtout en ce qui concerne la connaissance des langues étrangères. Sur ce point, des signes encourageants se manifestent pourtant dans les établissements scolaires du nord de la France. L’article de Bianca Versteeg publié dans ce même numéro traite, entre autres, de ce sujet.
Sans nier la réalité des progrès accomplis, mes amis des Hauts-de-France me signalent néanmoins que ceux-ci restent très lents. Ils me confient d’autre part qu’ils se trouvent confrontés pendant leurs visites en Flandre à une interlangue envahissante et à une diversité de dialectes éloignés du néerlandais standard qui leur a été enseigné. Ils témoignent aussi que nombre de leurs connaissances continuent de s’étonner que tous les Belges ne leur souhaitent pas la bienvenue dans un français impeccable. Les temps ont changé sans que tout le monde s’en rende compte.
Le pays le plus anglo-saxon du continent
Les Pays-Bas ont sur la Belgique l’avantage pratique d’être un État-nation unilingue. Même si la France reste la première destination de vacances des Néerlandais (et des Belges), la suprématie de l’anglais y a pris des formes extrêmes. Cette langue étrangère n’a pas seulement partiellement supplanté le néerlandais dans l’enseignement supérieur, elle semble maintenant être la seule à conserver un solide ancrage dans les établissements secondaires. Au temps où la maîtrise du français attestait d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture européenne, son apprentissage se faisait à l’école. Comme Filip Verroens le signale dans ce numéro, seules quatre universités néerlandaises proposent encore une formation en français, une vraie dégringolade!
La période où Paris était encore le pôle d’attraction vers lequel convergeait une foule d’intellectuels et d’artistes en exil volontaire ou forcé appartient à un passé révolu. Dans l’esprit de mai 68, la capitale française paraissait offrir une alternative à l’américanisme. Il n’en reste plus qu’une rhétorique de musée, que nul idéal européen ne pourra revitaliser. Seul un changement de mentalité des grands pays les amenant à jeter aux orties l’idée de supériorité à l’intérieur de leurs propres frontières peut remédier à cette situation.

Un fort tropisme anglo-saxon guidait déjà les choix économiques d’une politique néerlandaise de plus en plus marquée par le néolibéralisme. Ceci est loin d’être un détail. Est-il vraiment progressiste de privilégier les balances commerciales aux dépens des échanges culturels? C’est dans cet esprit que l’Institut Néerlandais parisien a rendu l’âme, entraînant dans sa chute la Maison Descartes amstellodamoise. L’Institut était un phare culturel, mais n’oublions pas qu’il subsiste plusieurs établissements innovateurs qui font du bon travail. Rien que pour Paris, on peut citer la Maison Biermans-Lapôtre, la Cité internationale des arts, l’Atelier Néerlandais et le Nouveau Centre Néerlandais.
Belgique-België, compliquée-complexée?
Je terminerai par le plus compliqué des trois pays, la Belgique. Depuis 1830, on voit dans ce royaume un État artificiel, sauf que cet État fonctionne – nonobstant toutes les critiques – depuis plus de 200 ans. Il s’étend de part et d’autre de la ligne de démarcation entre les zones d’influence germanique et latine, matérialisée depuis 1963 par la frontière linguistique.
Il fut un temps où tout Flamand ayant quelque ambition socioculturelle se devait d’être bilingue français-néerlandais. C’était encore le cas pour la génération de mes parents. À Bruxelles et en Flandre, cet ancien ordre des choses a laissé des traces dans l’enseignement. En Wallonie, les établissements scolaires dispensent des cours de néerlandais, mais la matière n’est toujours pas obligatoire (sauf dans certains établissements immersifs). La nécessité d’une connaissance approfondie de l’autre langue nationale est pourtant une évidence. Et cette connaissance s’accompagne d’un éveil à la culture, quand bien même chaque groupe linguistique continue de maugréer contre les difficultés de la langue parlée par le voisin.

© Lilartsy
Un double mouvement s’est produit entre-temps: d’une part l’émancipation culturelle de la Flandre, et d’autre part la fulgurante avancée de l’anglais qui tend à devenir la première langue étrangère de tout le pays. L’émancipation s’est produite parce que les Flamands considéraient que l’aspiration à l’autonomie conduisait nécessairement à s’interroger sur l’usage du français dans certains cercles ainsi que sur une certaine complaisance, en particulier politique, vis-à-vis des francophones (complaisance remontant à un douloureux passé où les « personnes parlant flamand » étaient traitées en citoyens de seconde zone). Mais le débat est clos depuis longtemps et la souveraineté culturelle a été scellée par une succession de réformes institutionnelles.
Le renouveau du nationalisme flamand ayant accompagné le décollage économique du nord du pays a eu deux effets collatéraux: une dévalorisation de l’apprentissage du français -déjà affecté par la baisse de qualité de l’enseignement des langues – conduisant parfois au refus pur et simple de l’apprentissage de cette langue. Dans le sud du pays, on constate un phénomène analogue. Pourquoi s’embêter à apprendre le néerlandais si les Flamands méprisent les francophones? Conséquence subsidiaire: de moins en moins d’élèves francophones choisissent le néerlandais comme première langue étrangère. L’anglais ne leur ouvre-t-il pas, de toute façon, plus de portes sur le monde? Ils oublient simplement qu’il ne leur ouvre pas celle du marché domestique ni celle des pays voisins, toute considération sur le Brexit mise à part.
Ce qui croît à Bruxelles, peut très bien fonctionner ailleurs.
Il est indéniable qu’un certain discours politique creuse un fossé entre les deux groupes linguistiques avec la complaisance des médias. Sans doute aurait-on tout à gagner à une pensée cosmopolite et à une action multilingue, à une conception de l’identité refusant le repli sur soi-même encouragé par une certaine rhétorique mais jetant au contraire sur le monde un regard ouvert.
La clef du problème se trouve à Bruxelles
Bruxelles est un chapitre à part. Les statistiques concernant cette métropole ont de quoi étonner: s’exprimer en néerlandais dans la vie publique y est devenu plus facile au cours des dernières décennies, tandis que la population a, en une vingtaine d’années, muté en un parfait cocktail multiculturel. Dans cette sympathique et complexe tour de Babel, le français n’est langue unique de communication que dans 50 % des familles, et la langue maternelle des deux parents n’est le néerlandais que dans 5 à 10 % des familles. La ville continue de bénéficier de la présence des deux réseaux éducatifs, francophone et néerlandophone. Si le français y demeure sans conteste la lingua franca, de plus en plus de jeunes Bruxellois d’origines diverses engagent le dialogue en anglais, tout comme les membres de la colonie européenne qui ont été amenés à s’y établir. Bruxelles reste l’espace d’échange le plus actif entre francophones et néerlandophones malgré certains phénomènes de ghettoïsation. Eux aussi sur le déclin.
Compte tenu de la multitude de lieux où les deux communautés cohabitent concrètement, on peut penser que c’est à Bruxelles que se trouve la clef de leur rapprochement. La ville ne manquait certes pas de temples culturels bilingues, mais ces nouveaux espaces de rencontre ont souvent un ADN marqué par les activités socio-culturelles; ils ont grandi organiquement dans les quartiers, souvent à la suite d’initiatives privées, dans un style très Do It Yourself (DIY): ouvert et curieux. Tous dans le même bateau, «quoi»! Quand bien même il arrive que ces bateaux tanguent et ne naviguent pas à la même allure. Mais ainsi va le DIY. Ces phénomènes relativement nouveaux ne tiennent par ailleurs aucun compte des directives étatiques ou linguistiques. Demandez aux Bruxellois: ils s’en passent fort bien.
 Des visiteurs du festival Couleur Café à Bruxelles entrent sur le site de l’événement
Des visiteurs du festival Couleur Café à Bruxelles entrent sur le site de l’événement© L. Van Laethem
En guise de conclusion, je dirai qu’un profond changement de mentalité me paraît possible, et qu’il peut éclore au cœur de l’Europe, dans la capitale belge, là où surgit l’intérêt pour la diversité des langues et des cultures, là où les échanges s’intensifient et s’étendent. Les interventions étatiques et le primat du libre marché ne sont pas, à mon sens, les seuls facteurs déterminant nos relations par-delà les frontières; la prise de conscience par les citoyens de leur capacité d’autonomie et d’auto-organisation est appelée à jouer un rôle fondamental. Ce processus s’appuie sur cette disposition mentale, sur cette sorte de confiance a priori. Profitons de ce nouvel esprit pour prendre des initiatives à la base et tisser des liens: soyons créatifs et curieux, partons à la rencontre les uns des autres!
Ce qui croît à Bruxelles peut très bien fonctionner ailleurs. Là comme ailleurs, la pratique précède les politiques publiques et accouche d’un espace autre : une réalité parallèle et stimulante. Complexe, mais pas complexée.