Dans les brumes : le quartier des marins d’Anvers à travers les yeux d’auteurs francophones
Les transformations du port d’Anvers ont fait disparaître son quartier des marins dans les brumes du temps. Comment les auteurs d’expression française l’ont-ils décrit ou évoqué ?
Les
auteurs français aiment évoquer la Belgique. À peine ce nom
est-il lâché qu’un autre monde s’ouvre, indéfectiblement
associé à un pays resté en grande partie imaginaire. Une telle
vision de la Belgique se résume souvent en un mot: «le Nord». Elle
comprend tout un ensemble d’éléments, dont la plupart n’ont pas
changé depuis le début du XIXe
siècle. Certains sont très visuels et sensoriels: la pluie, le
brouillard, la bière, la brique et, accessoirement, les rues et les
places bordées de maisons aux toits pointus. D’autres sont moins
tangibles mais tout aussi présents: le goût du silence qui
n’interdit pas l’exubérance, l’omniprésence de l’histoire,
le folklore qui n’est pas qu’un mot mais une culture bien
vivante, le rôle du catholicisme ou l’attachement de tout Belge à
sa ville.
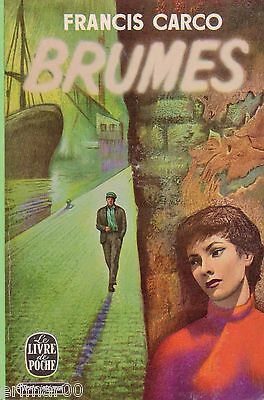
De
même que le Schipperskwartier,
le quartier des Marins, fait partie d’Anvers, Anvers fait partie de
la Belgique. La formulation peut paraître absurde, mais elle
explique le prisme à travers lequel la littérature française
regarde ce quartier portuaire. Le quartier des Marins perd sa
majuscule initiale, d’une certaine manière, et devient communément
le «quartier des marins». La description débouche vite sur une
évocation, moins vague que syncrétique, dans laquelle fusionnent
plusieurs images. Le quartier des marins devient une référence ou
un signe, des pièces de ce puzzle imaginaire appelé «le Nord».
Il
serait cependant erroné de généraliser cette vision exotique du
quartier des marins à Anvers et de l’extraire de son contexte
historique. Même les stéréotypes suivent des tendances.
Romantisme
Brumes
(1935), l’un des derniers ouvrages de Francis Carco (1886-1958),
constitue un bon point de départ pour une rétrospective. Carco,
aujourd’hui pratiquement oublié, était un romancier, journaliste
et chansonnier célèbre dans l’entre-deux-guerres qui aimait
dépeindre dans ses textes les bas-fonds de la société.
L’expression «le milieu» est de lui. Ses personnages sont de
préférence des proxénètes, des bohèmes, des marins, des malfrats
ou des aventuriers.
Carco
est avant tout un romantique sombre, fasciné par ceux qui ne peuvent
ou ne veulent trouver leur place dans la société bourgeoise. Rien
ne peut mieux illustrer le regard syncrétique et générique porté
sur «le» quartier des marins que les premières phrases de son
roman Brumes:
Il n’était que trois heures de l’après-midi, mais une petite
brume roussâtre flottait entre les antiques et sordides masures de
la rue des Bouchers dont les façades aux frontons à redans et les
toits de tuiles noires suintaient d’humidité. Sur les trottoirs,
sur les pavés, la même humidité visqueuse faisait briller la terne
lumière du jour. Vers le porche de la haute tour de briques de
Réguliers, des degrés flanquaient un côté de la rue qui suivait
la déclivité du train et formait une espèce de cuvette pleine
d’une eau croupissante, semée de détritus.
Rien ne
manque. Entre «brume» et «brique», le tableau offre tout ce qui
peut évoquer un quartier de marins typique du «Nord» comme on aime
le voir de France: un monde marginal, entièrement livré à
lui-même, plongé dans l’obscurité et le marasme, oublié par le
temps, avec l’annonce, dès les premières lignes du roman, de la
tragédie qui doit avoir lieu: la «rue des Bouchers» n’est pas
une rue pour touristes ou fêtards, mais un lieu où le sang va
couler.
 Jacques Audiberti (1899-1965).
Jacques Audiberti (1899-1965).Carco
est avant tout un romantique sombre, fasciné par ceux qui ne peuvent
ou ne veulent trouver leur place dans la société bourgeoise. Rien
ne peut mieux illustrer le regard syncrétique et générique porté
sur «le» quartier des marins que les premières phrases de son
roman Brumes:
Il n’était que trois heures de l’après-midi, mais une petite
brume roussâtre flottait entre les antiques et sordides masures de
la rue des Bouchers dont les façades aux frontons à redans et les
toits de tuiles noires suintaient d’humidité. Sur les trottoirs,
sur les pavés, la même humidité visqueuse faisait briller la terne
lumière du jour. Vers le porche de la haute tour de briques de
Réguliers, des degrés flanquaient un côté de la rue qui suivait
la déclivité du train et formait une espèce de cuvette pleine
d’une eau croupissante, semée de détritus.
Rien ne
manque. Entre «brume» et «brique», le tableau offre tout ce qui
peut évoquer un quartier de marins typique du «Nord» comme on aime
le voir de France: un monde marginal, entièrement livré à
lui-même, plongé dans l’obscurité et le marasme, oublié par le
temps, avec l’annonce, dès les premières lignes du roman, de la
tragédie qui doit avoir lieu: la «rue des Bouchers» n’est pas
une rue pour touristes ou fêtards, mais un lieu où le sang va
couler. Pour autant, s’agit-il d’Anvers ou d’une ville portuaire quelconque du nord de l’Europe? Les descriptions littéraires livrent souvent autre chose que la réalité. Et dans bien des cas cet «autre chose» correspond à une refonte des opinions et des images.
Jacques Audiberti (1899-1965) aussi est un romantique pur et dur, mais d’une tout autre psychologie et d’une autre orientation littéraire que Francis Carco. En 1942, il publie dans La
Nouvelle Revue française un texte entre fiction et autobiographie, dont l’action se situe très explicitement dans le quartier des marins à Anvers.
© «Van Mieghem Museum», Anvers.
La
Maison de l’estuaire débute sur une
scène portuaire qui, contrairement à celles de Carco, repose sur
l’observation directe:
Par-dessus tout elle aimait voir les grands navires remonter
l’estuaire, tirés par deux remorqueurs côté à côté pareils à
deux chevaux et reliés aux mâtures par des cordes d’acier tendues
comme des rênes. L’un de ces remorqueurs au profil rebroussé,
c’était, par exemple, l’Infatigable, l’autre, le Gouverneur
Ratelier (sic). D’un glissement égal ils tranchaient ensemble le
courant, minuscules, en avant des colosses qu’ils déplaçaient.
Vers la mer, de hautes plages grises, vernies de vert dans la brume,
fermaient le fleuve, pour les regards.
Le
récit se concentre ensuite aussitôt sur «elle», Noira Kœrker, un
personnage perpétuellement en quête du grand amour. Le texte passe
néanmoins rapidement à la première personne, au singulier comme au
pluriel, avec l’arrivée du narrateur et de son ami dans la «ville
politique» du pays et leur virée dans le quartier du port.
L’espace
dans lequel se déroule le récit offre de nombreuses analogies avec
les lieux prototypiques que Carco affectionnait, quoique le réalisme
qui s’en dégage soit ici bien plus poussé. Les références à
Anvers sont d’une grande précision, mais surtout sans que des
détails génériques viennent les parasiter. Pour autant, le nom
d’Anvers n’apparaît jamais. Audiberti fait le choix de la
symbolisation.
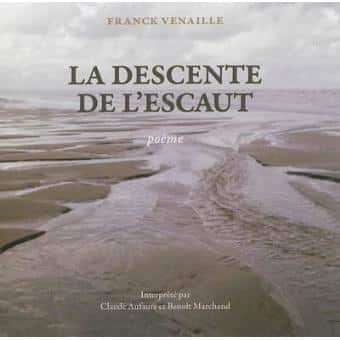
Plus
précisément, tout est vu sous l’angle de la dualité: deux
remorqueurs et non un; deux Parisiens et non un; deux pays et non un.
Bien vite, réalité et personnages apparaissent comme dédoublés:
la Belgique, dont le nom n’apparaît jamais, a deux langues et deux
cultures, Noira est un personnage qui mène une sorte de double vie
et on peut deviner entre les lignes que l’ami du narrateur n’est
peut-être que le reflet de son propre moi. Le contexte historique ne
relève en rien de l’anecdote: en 1942, la
Nouvelle Revue française est
(indirectement) sous contrôle allemand et l’ensemble du texte
d’Audiberti traduit un profond malaise, comme si l’auteur prenait
prétexte de son voyage à Anvers pour afficher sa francité.
Évitement
ou disparition dans les brumes du temps
Le
recueil de Franck Venaille (° 1936) intitulé La
Descente de l’Escaut (1995) est tout
aussi romantique. Aujourd’hui, c’est presque un classique. Il
représente certes un tour de force rhétorique par la richesse de la
palette des voix et des registres que l’auteur laisse, sans
difficulté apparente, se chevaucher dans ce poème épique, mais
c’est aussi le récit très personnel d’une crise existentielle
et la quête d’une réponse dans la littérature et en dehors aux
grandes questions de la vie.
Contrairement
à Audiberti, Venaille est un auteur qui a toujours eu des affinités
avec la Belgique. Sa fascination et son amour pour la Flandre se
retrouvent dans nombre de ses écrits et pas seulement dans La
Descente de l’Escaut, le recueil qui
fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait: descendre l’Escaut de
la source à l’embouchure pour se trouver:
Je marche en parlant. Çà! Qu’ici l’on s’exprime et peu
importe dans quelle langue! Les mots craignent-ils la brume? Ont-ils
peur de ce livre ouvert: le brouillard! Je fais ma guerre. J’attaque
et viole ma langue maternelle. Je la regarde se balancer sur les
gibets. D’où me vient cette fureur? Me mettrais-je à haïr ma
mère après l’avoir, tant de mois, portée? Eau trouble. Écluses
qui, d’effroi, se vident. Voici l’instant où se mettent en
marche les péniches et cela me rappelle le départ d’une
manifestation où domineraient drapeaux noirs jaunes et rouges.
J’eusse dû m’engager comme soutier. Vivre dans la majesté du
mazout.
Du
point de vue thématique, peu de surprises par rapport aux textes
précédents: l’inévitable brouillard, le décor quasi médiéval
avec son gibet, l’omniprésence de l’eau, la nature, la perte de
contact avec sa langue maternelle dans un environnement étranger.
Une nouveauté en revanche: l’attention accordée à la
littérature belge.
C’est
un cliché de dire que tout écrit s’inspire et se nourrit de
textes littéraires. Venaille va plus loin: il présente l’ensemble
de son texte comme un dialogue comportant des fragments d’auteurs
belges flamands et francophones. Aussi est-ce bien plus par le biais
de ces citations que par celui des textes proprement de Venaille, que
le lecteur peut s’orienter en direction des villes zélandaises de
Breskens et de Flessingue.
Ces
citations jouent un rôle décisif dans l’évocation du quartier
des marins à Anvers. Les citations de Venaille font ressortir
l’évitement de cet environnement. La seule citation faisant
explicitement référence à Anvers est celle de l’écrivain
flamand Ivo Michiels (1923-2012),
qui évoque des souvenirs de jeunesse ayant pour cadre le Vogelmarkt
et les sorties à la plage Sint-Anneke.
Rien
d’étonnant à ce que le jeune Michiels, toujours aux côtés de
son père lors des promenades dominicales, ne s’aventure pas dans
le quartier des marins, car un père de famille accompagné de son
fils n’aurait rien à y faire. Ce que le texte d’Ivo Michiels
passe sous silence, le texte de Venaille le dévoile, quelques pages
plus loin:
Notre
errance.
Ah!
L’enfant au tablier noir, au col blanc empesé, aux
mains
petites, habiles toutefois à donner le plaisir interdit
par
qui, Dites! Je suis moi-même l’ancien enfant qui consomme
ses
deuils comme d’autres ces boissons bleues bues
près
des femmes si décolletées qu’elles donnent envie de mourir.
Et
lorsque le poète insère une scène d’amour proprement dite, il
part d’un texte de l’écrivain anversois francophone Paul Willems
(1912-1997),
à même de symboliser le quartier des marins et le genre d’animation
qui y règne, mais non d’en donner une quelconque description:
Après le tombeau, il dessina une maison close. Les chambres, les
salons, les couloirs étaient enserrés de murs d’eau maintenus par
des parois de verre. Les sols étaient matelassés de lits plains. Un
léger courant animait l’eau où flottaient des objets et des
images… Bouteilles d’encre, armoires, tubes de couleurs, pot au
lait, dérivaient lentement dans l’eau, se renversaient et
répandaient leur contenu en larges bouffées qui ressemblaient à du
sperme noir. Il y avait aussi de hautes et impassibles images qui
flottaient comme des noyés.
Ce
texte surréaliste sert d’introduction à une scène érotique que
nous pouvons associer au quartier des marins, car en descendant
l’Escaut nous sommes arrivés plus ou moins à sa hauteur, mais qui
permet surtout de souligner le ton et le style de Venaille, lequel
fait le choix d’une langue recherchée:
D’entre
les cuisses blondes sourd l’eau claire où se trempe le
Pénitent.
Celui qui tant t’aimait! Celui qui, las désormais, va
De
jour en jour dérivant.
 Jacques Darras.
Jacques Darras.La Descente de l’Escaut est un poème certes très lié au concret, mais dépouillé de toute forme d’objectivisme. L’horizon du texte est ce voyage, au sens allégorique d’un rituel purificateur, et pour cette raison il importe d’éviter de fournir des références géographiques concrètes ou, mieux encore peut-être, de ne les donner que pour les mettre rapidement entre parenthèses.
«Moi j’aime la Belgique» constitue la première partie de La Maye réfléchit (2009). L’auteur de ce texte, Jacques Darras (° 1939), est, à partir de son domicile d’Amiens, l’un des principaux acteurs du dialogue entre la France et la Belgique. Comme traducteur, anthologiste, théoricien et organisateur, enseignant et performeur, mais avant tout poète.





