Entretien avec Jan Baetens, auteur néerlandophone qui publie en français
Poète, essayiste, chercheur, professeur émérite de la KU Leuven, critique, commissaire d’exposition, Jan Baetens est l’auteur d’une œuvre marquante, couronnée par de nombreux prix, qui explore tant la poésie que le roman-photo, la novélisation ou encore les relations entre le texte et l’image. De langue maternelle néerlandaise, il a construit son œuvre en français. Avec le présent entretien, nous voyageons dans la galaxie Jan Baetens.
Jan Baetens, pouvez-vous exposer une des constantes de vos recueils poétiques, à savoir la focalisation sur des champs de la vie quotidienne et la manière dont l’écriture parvient à penser ces différents registres? Quel lien établissez-vous entre ce phénomène et votre essai-manifeste au titre explicite, Pour en finir avec la poésie dite minimaliste (Les Impressions nouvelles, 2014)? Quelles sont les lames de fond de vos créations qui se présentent comme une «machine de guerre» (Deleuze et Guattari) contre la poésie minimaliste actuelle?
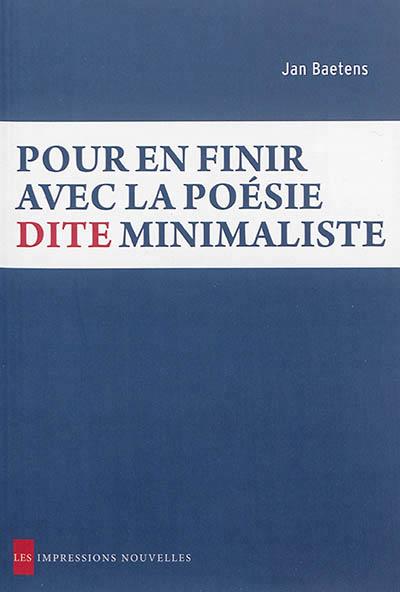
Jan Baetens: Au risque de vous surprendre, ma réticence à l’égard de la poésie minimaliste est très relative. Comme toujours, tout dépend de ce qu’on entend par les mots qu’on utilise. Le caractère volontairement tautologique du minimalisme des années 1980 et 1990 et son rejet de toute forme d’écriture qui désigne le monde plutôt que le texte, puis son ambition de produire sinon un savoir, du moins une expérience de nature philosophique, m’ont toujours paru un appauvrissement de ce qu’on peut et doit attendre de la poésie: une nouvelle manière de comprendre, puis de vivre ce qui nous entoure et partant nous fait.
Mais cette autre manière de voir et d’écrire la poésie doit elle aussi porter le sceau du minimalisme, mais autrement: je tiens à la sobriété du langage, je défends mon goût du quotidien dans ce qu’il a de plus direct et de plus banal, je maintiens le parti pris de la lisibilité (mais simple n’est pas synonyme de simpliste, tout comme complexe ne veut pas dire compliqué). Je me revendique volontiers de ce minimalisme-là, qui est surtout affaire d’équilibre, de balance entre le trop et le pas assez. Je ne suis pas en guerre contre la poésie minimaliste, j’essaie plutôt d’utiliser des questions et techniques dans une perspective un rien différente.
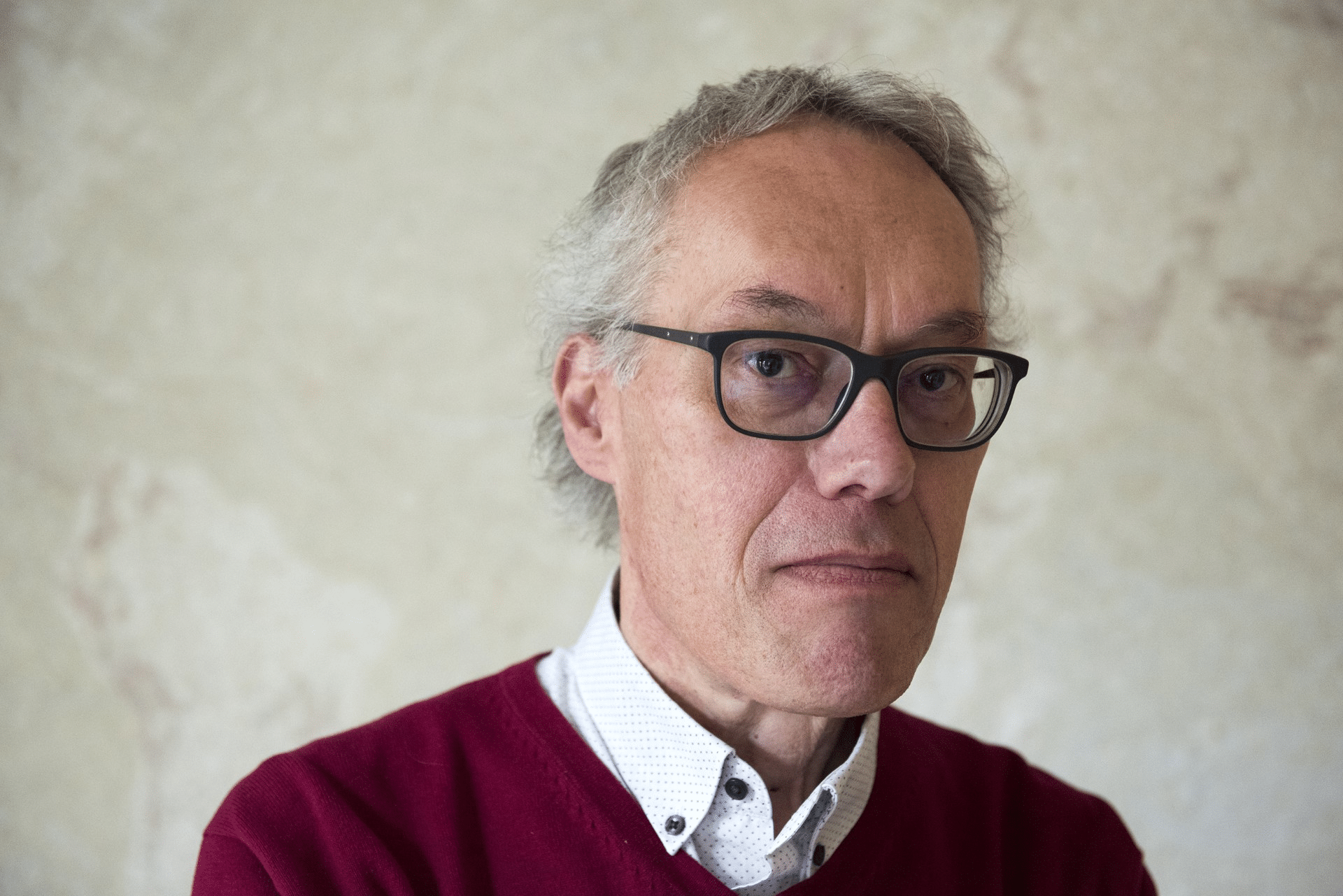
© Marie-Françoise Plissart
Vous affectionnez la poésie à contraintes, l’esprit Oulipo qui irrigue notamment vos premiers recueils. Au nombre des contraintes qui poussent l’écriture à développer de nouveaux horizons, vous parlez souvent de votre choix d’écrire en français, dans un idiome qui n’est pas votre langue maternelle. Quelles sont les possibilités formelles, stylistiques, conceptuelles que la discipline de la contrainte délivre? Le français n’est-il pas devenu une seconde langue maternelle?
Jan Baetens: L’Oulipo peut à juste titre s’enorgueillir d’avoir redonné droit de cité aux techniques d’écriture sous contrainte condamnées par le romantisme, puis plus largement par le culte de l’écriture comme expression d’un moi authentique bridé par les lourdeurs de la langue et des conventions.
Mais tout comme il y a minimalisme et minimalisme, il y a contrainte et contrainte, et on se trompe à limiter le domaine de la contrainte aux seules formes oulipiennes, qui accordent un prix excessif à la recherche de l’originalité (comme si une contrainte inédite valait mieux qu’une contrainte déjà dûment répertoriée et pratiquée) et à la difficulté de l’exécution (parfois les formes élémentaires sont plus efficaces qu’un excès de raffinement).
Le français est-il devenu ou non une seconde langue maternelle? Je ne suis pas sûr que la question soit importante pour qui me lit.
Si j’ai énormément appris des contraintes, je ne les ai jamais considérées comme un but en soi. Ce sont des moyens, fort utiles dans la mise en forme de ce qu’on essaie de dire mais qui n’ont rien d’absolu: je ne me gêne nullement d’en faire un usage parcimonieux, ponctuel, éphémère, opportuniste si vous voulez, puis de les oublier, c’est-à-dire de passer à autre chose.
Quant à savoir si le français est devenu ou non une seconde langue maternelle, je ne suis pas sûr que la question soit importante pour qui me lit. Idéalement, moins on pense à l’auteur ou à l’autrice en lisant un texte, mieux ça vaut (ce qui n’empêche évidemment pas, mais après la lecture, de s’intéresser à la vie et aux idées de l’écrivain, tant qu’on se réserve la possibilité de faire une lecture qui ne soit pas d’emblée disciplinée par la biographie).
Vous êtes l’auteur de nombreux livres-objets, d’ouvrages articulant un dispositif texte et image. Je pense à vos collaborations avec Olivier Deprez, Marie-Françoise Plissart, Milan Chlumsky. Les passerelles que vous établissez entre le champ du verbe et celui de l’image renvoient-elles, de près ou de loin, à la traversée des langues que vous pratiquez?
Jan Baetens: L’image, gravée ou photographique, est en effet capitale pour moi, mais je pense le rapport entre le lisible et le visible en fonction de l’imprimé (de la reproduction, donc), et du livre dans toute l’épaisseur de son existence matérielle. Les mots sont pour moi des mots sur la page; les photos et gravures ne sont pas séparables du support qui les accueille. Le dialogue des signes change radicalement en passant d’un «dispositif» à l’autre et je reste très attaché au papier.






Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.