Érasme, icône du style clair et élégant, de la latinité et de l’érudition
Érasme (1466-1536) était un homme de son temps, peut-être pas de tout temps.
Peut-on inventer un chef-d’œuvre sur la croupe d’un cheval? Érasme a conçu L’Éloge de la folie dans les Alpes, au cours de son retour d’Italie en 1509. Le livre a été écrit dans le cadre stimulant de la famille de Thomas More à Londres, sans l’aide de la bibliothèque d’Érasme, qui n’était pas encore arrivée.
Érasme avait passé trois ans en Italie, avec des sentiments ambigus.
Dès qu’il eut passé les montagnes, il obtint sa bulle de docteur en théologie à Turin. À Bologne, il assiste à l’entrée triomphale du pape Jules II.
Autant d’années d’incubation pour son Éloge. Le pays ne répond pas aux grandes espérances qu’il avait nourries. Trop de bellicisme, une Église qui affiche trop de pouvoir, d’ostentation et de superbe, des humanistes italiens qui toisent de haut les «barbares» venus du Nord, alors qu’Érasme savait très bien que ses connaissances du latin et du grec n’avaient rien à leur envier, bien au contraire. Quant aux nouveautés transalpines en matière d’architecture et de sculpture, Érasme n’en avait cure. La peinture aussi le laissait indifférent. Cet humaniste pur-sang n’était pas un homme de la Renaissance. Il n’avait d’yeux que pour les livres. Heureusement, il y avait à Venise l’éditeur Aldus Manutius, pour publier sa mine d’or de connaissances sur l’Antiquité classique, les Adages.
 Hans Holbein le Jeune, Portrait d'Érasme, 1523, «National Gallery», Londres.
Hans Holbein le Jeune, Portrait d'Érasme, 1523, «National Gallery», Londres.Et le voilà de nouveau juché sur la croupe d’un cheval. Il sait maintenant avec certitude que l’Église a besoin d’une réforme et que le pape Jules II n’ira pas au paradis. Et à présent, ce ne sont plus des poèmes qui fermentent en lui, mais de nouvelles « niaiseries », des nugae :
Peitho, la déesse de la Persuasion, lui susurre une declamatio. La déclamation est un exercice en formation rhétorique. Celle d’Érasme appartient au genus demonstrativum, la rhétorique de circonstance ou cérémonielle. Le genre est d’usage au cours de fêtes, commémorations et enterrements, où l’on attend souvent une laudatio (louange). Mais la vituperatio (la diatribe) appartient au genre, elle aussi. La declamatio est un tour de force rhétorique pour virtuoses. Dans l’Antiquité, des sophistes itinérants allaient de ville en ville tenir ces discours ronflants devant un public qui les écoutait avec enthousiasme et ferveur chanter les louanges de la mouche ou de la calvitie.
Dans le cas d’Érasme c’est Stultitia, Dame Sottise, qui monte en chaire pour faire l’éloge de la Folie.
Stultitiae Laus signifie en effet tant l’Éloge dit par la Folie elle-même que l’Éloge de la Folie. Ainsi, Érasme fait d’une pierre deux coups : son discours tient tout à la fois de la laudatio
et de la vituperatio. Qui plus est, en le mettant dans la bouche de la Folie elle-même – et l’auteur hors d’atteinte – il la rend fondamentalement équivoque et énigmatique. À la vérité, Érasme jongle avec deux conceptions de la Folie dans cet ouvrage : d’une part, démasquant la soi-disant sagesse, il dévoile sa réelle sottise et la fustige : de l’autre, louant la salutaire sottise, un ingrédient indispensable à l’existence, il va jusqu’à la porter au rang de seule et véritable sagesse.
La déclamation se termine par une ode passionnée à l’extase mystique, une forme d’égarement qui est une préfiguration de la béatitude céleste, réservée à un petit nombre de chrétiens. D’après Paul, Dieu avait rendu folle la sagesse du monde et l’annonce d’un Christ crucifié était une folie (Moria) pour les païens (1 Corinthiens 1 : 18-25). Mais Stultitia ne serait pas Stultitia si elle ne se dérobait pas au dernier moment à toute interprétation équivoque : « Je vois que vous attendez un épilogue, mais vous avez vraiment perdu l’esprit si vous croyez que je me souviens encore de ce que j’ai dit, alors que j’ai déversé un tel fatras de paroles. Voici un dicton antique : « Je hais le compagnon de beuveries qui a de la mémoire« . En voici un nouveau : « Je hais l’auditeur qui a de la mémoire« . Eh bien, portez-vous bien, applaudissez, vivez, buvez, très illustres initiés de Moria. » Fin.
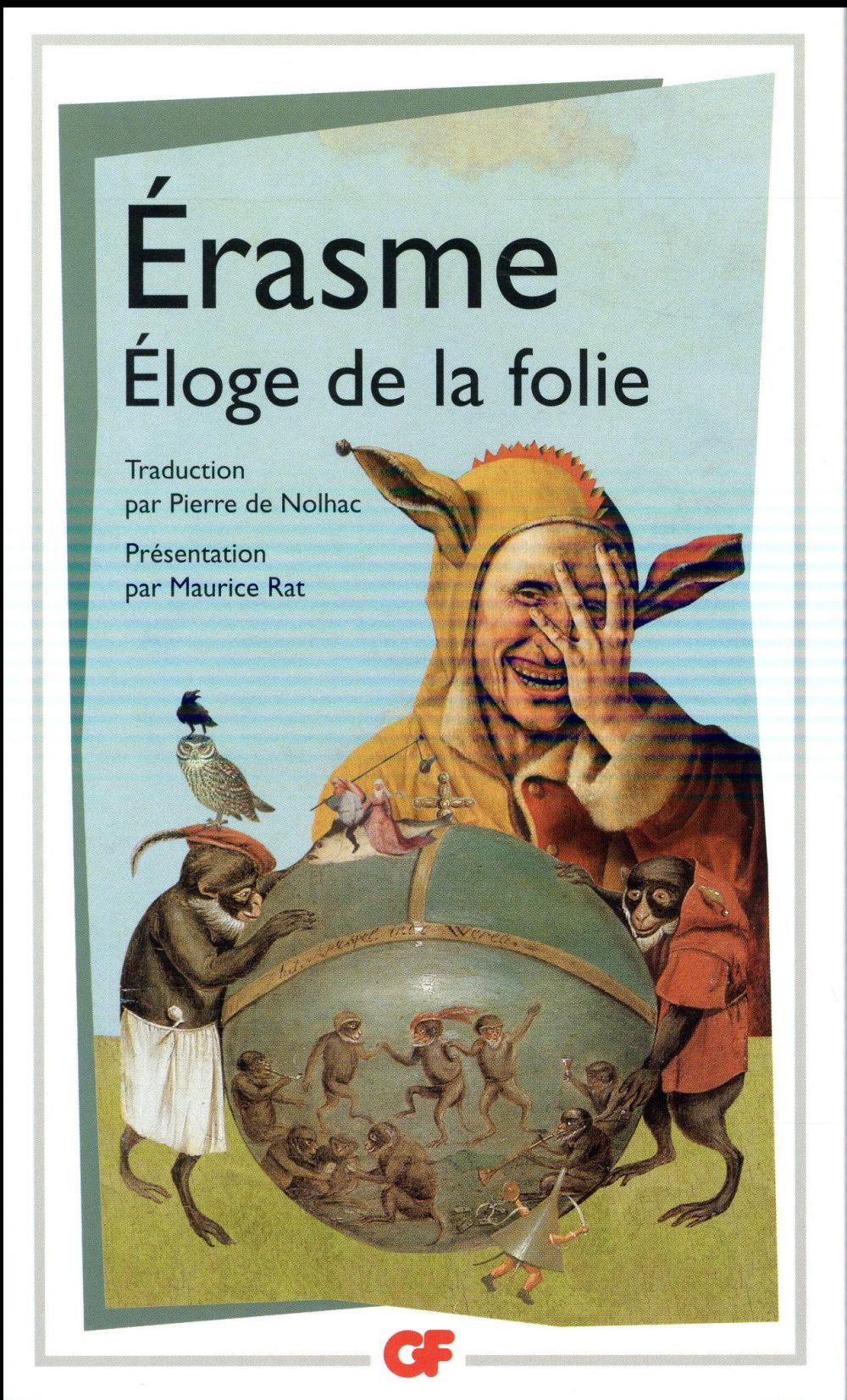
Et elle descend de la chaire, laissant ses auditeurs – et nous lecteurs – ébahis, tels que Hans Holbein le Jeune les avait représentés dans son dessin en marge du célèbre exemplaire de Bâle de 1515. Insaisissable tant qu’elle parle, sa tarentelle de mots envoûte encore longtemps. Jusqu’à ce que le charme se rompe.
Nous l’avons compris : dans la tradition rhétorique avec sa longue histoire, l’indignation qu’Érasme a éprouvée en Italie a trouvé une forme unique en son genre et l’a ciselée de main de maître au profit et surtout au grand plaisir d’esprits érudits. L’ouvrage est une carte d’échantillons d’intertextualité (tout l’acquis des Adages y repasse en dansant), ou l’imitatio (imitation de la forme et du contenu des modèles) et l’aemulatio
(la rivalité avec les mêmes modèles), comme le prescrit la littérature antique. L’effet thérapeutique de l’écriture, quoiqu’involontaire, était le bienvenu. Pour ma part, je soupçonne qu’il a même été effrayé par les réactions violentes qu’a suscitées ce livre – il avait dû le voir comme un divertimento – car il se répandit dès lors en excuses pour ce petit ouvrage de circonstance. Il serait sans doute fort embarrassé de savoir que ce livre est quasiment le seul que l’on associe encore à son nom, de nos jours.
Respublica litterarum
L’ expression «La République des lettres» a été utilisée pour la première fois en 1417, dans une lettre que Francesco Barbaro envoya à son collègue humaniste Poggio Bracciolini. Ce dernier ayant retrouvé dans différents monastères européens des manuscrits d’auteurs romains et grecs que l’on croyait à jamais perdus, Barbaro le remerciait d’avoir de la sorte réjoui et enrichi la Respublica litteraria
(sic).
L’expression désigne à la fois la connaissance des «lettres» et ses praticiens: les «lettrés» ou «savants». À cet égard, il est important de noter que le terme litterae ne se limite pas à la littérature ou aux belles-lettres; il se réfère à toutes les disciplines scientifiques et connaissances acquises par l’étude et consignées dans des livres, c’est-à-dire aux sciences alpha et bêta, soit respectivement les sciences humaines et les sciences naturelles.
La métaphore de «République» présente deux connotations: l’égalité qui règne entre ces «lettrés» s’adonnant à la recherche et à l’acquisition de connaissances, d’une part, et leur liberté d’action en tant que «citoyens» de cette communauté, d’autre part.
La République des lettres qui connut sa floraison entre 1500 et 1750 n’est rien d’autre qu’une république d’esprits libres qui se placent sous l’autorité protectrice de la raison et dont le but est de servir la science et la vérité. Ils estiment qu’il est de leur devoir de partager et de diffuser les connaissances.
Érasme fut la première figure emblématique de cette République. Sa méthode philologico-critique de lecture des textes de la Bible et des Pères de l’Église en vue de découvrir les pratiques du christianisme primitif allait précisément contribuer à la réforme de la chrétienté européenne, mais aussi aux déchirements en son sein. Néanmoins, Érasme continua à croire en l’existence d’une communauté idéelle d’érudits qui, au-delà de toutes les divisions nationales et religieuses, vivaient comme des citoyens du monde dans une patrie commune.
Cette communauté existait dans son réseau épistolaire, formant à ses yeux une préfiguration de la véritable Respublica christiana.
« Érasme ? Il ne fait qu’écrire »
Dans un diagramme de l’humaniste français Charles de Bouelles, datant du début du XVIe siècle et portant sur la place de l’homme dans le monde, la paresse ou la lenteur, accidia, figure au niveau d’existence le plus bas : celui de la pierre. L’homme qui est à ce niveau n’arrive même pas à vivre (comme une plante), à sentir (comme un animal), et encore moins à comprendre (comme un être humain) : il ne fait qu’exister comme un corps minéral, une pierre. Le diagramme le représente par une figure assise, recroquevillée avec la tête sur les genoux.
Aujourd’hui Érasme est surtout une icône de tolérance et de civilisation, un terme générique vide. En son temps, il était surtout une icône du style clair et élégant, de la latinité et de l’érudition.
L’ambiguïté du diagramme se situe dans le fait que l’homme parfait, homo studiosus, l’« intellectuel », disons, est aussi une figure assise. Il est installé devant un pupitre et armé de la plume : un lecteur, un copiste et exégète, un copieur et plagiaire, un commentateur. L’icône de l’intellectuel classique est l’Érasme écrivant tel que Holbein l’a peint. « Le geste essentiel de toute son existence », disait Alphonse Roersch. Un siècle après Érasme, Pascal écrirait que tout le malheur des hommes venait d’une seule chose, qui était de ne pas savoir demeurer au repos, dans une chambre.
L’Europe a toujours connu la tension entre les partisans de la vie contemplative (vita contemplativa) et les apôtres de la vita activa. Le contemplatif s’est entre autres retranché derrière les murs des cloîtres et plus tard, des universités. Il s’exclut littéralement et figurativement, il se met en marge, mais il se sait supérieur. Là est sa revanche.
Érasme ne se réfugia pas dans un cloître ou une université mais dans… une imprimerie. C’était sa ligne extérieure avec le monde. Il fut l’un des premiers publicistes à se servir de la presse comme d’une arme et à lui valoir sa célébrité. Mais celle-ci se retourna contre lui comme un boomerang, car dans le monde réel, on lui demandait de pratiquer des choix univoques, dont il n’était pas capable. « Tantum scribit », entendait-on dire avec déception et mépris du côté protestant : il ne fait qu’écrire. Érasme était destiné à corriger et compléter sans fin des épreuves, et non à clouer des pamphlets aux portes des églises ou à se révolter contre un empereur.
La palinodie d’Huizinga
Johan Huizinga (1872-1945), le plus grand historien hollandais du XXIe siècle émet ce jugement assez sévère sur son compatriote :
« Érasme paraît parfois être l’homme qui n’était pas assez fort pour son temps. En ce fougueux XVIe siècle, c’est la force du chêne d’un Luther, l’acuité d’acier d’un Calvin, la ferveur d’un Loyola qui étaient nécessaires, pas la douceur de velours d’Érasme. » Érasme est trop délicat, trop peu héroïque au goût d’Huizinga. Loyola ne sentit-il pas sa dévotion se refroidir, dit-on, à la lecture de l’Enchiridion militis christiani (le Manuel du Soldat chrétien) d’Érasme ?
 Johan Huizinga (1872-1945).
Johan Huizinga (1872-1945).Plus tard, en 1936, Huizinga rectifie quelque peu le tir au sujet d’Érasme. Dans le discours qu’il prononce au congrès Érasme de Bâle, à l’occasion de la célébration du quatrième centenaire de la mort de l’humaniste, il dit que les temps ont changé : on hait la paix, la modération et la tolérance et c’est pourquoi Érasme, l’esprit érasmien auquel l’héroïque est étranger, est plus actuel que jamais, sa nécessité est celle d’un remède. L’époque a besoin d’Érasme, parce qu’elle a besoin de mansuétude et de raffinement.
Souvenez-vous de la date : 1936. Je sais que la comparaison avec les années 1930 est facile, trop facile. L’histoire ne se répète pas. Mais un temps qui hait la paix, la modération et la tolérance…eh bien, on pourrait dire cela du nôtre.
Huizinga avait entre-temps développé sa critique sur le « hemd-en-hand-heroïsme » (l’héroïsme de la chemise (brune), de la main (levée) des années 1930. Bien qu’il restât dans la ligne de « la force du chêne », « l’acuité de l’acier », « la faveur », « l’héroïsme véritable », il comprenait maintenant qu’ils étaient montés en graine. « Ne serait-ce que comme calmant, un ajout de quelques gouttes d’Érasme ne ferait pas de mal », dit-il[1]. La formule étonne et montre une fois encore que Huizinga demeure ambigu au sujet d’Érasme : sa douceur a beau être à nouveau nécessaire, sa « cérébralité placide » continue à le déranger.
Icône
Aujourd’hui Érasme est surtout une icône de tolérance et de civilisation, un terme générique vide, où l’on peut fourrer tout ce qui est positif.
Son nom est devenu le drapeau pour les voyages d’étudiants d’une université à une autre en Europe. Parfois ces étudiants ne prennent – hélas ! – des vacances qu’en anglais, le latin d’aujourd’hui.

En son temps, il était surtout une icône du style clair et élégant, de la latinité et de l’érudition. Un homme civilisé était à ses yeux aussi un lettré, qui apprenait à parler et à écrire comme il sied en savourant les auteurs grecs et romains. Son choix radical du latin l’a finalement mis hors-jeu. Il ne s’adresse plus à nous, parce que peu d’entre nous le comprennent encore, et moins encore sont familiers du monde dans lequel son esprit vivait : celui de l’Antiquité et des bonae litterae (les belles-lettres), évangélisé par la foi chrétienne avec les sacrae litterae (la bible et les Pères de l’Église). Pour contrer la langue et la logique obscures du Moyen Âge les humanistes voulaient retourner à la luminosité du latin et aux codes rhétoriques de l’Antiquité. C’est aux sources que l’eau était pure. Ils étaient en premier lieu des philologues au sens plein du mot : des gardiens et des amants du mot, correct, lumineux, élégant et approprié. Penser clairement suivait d’une traite.
En ce sens, Érasme tenait sans doute ses Adagia et son édition critique du Nouveau Testament grec pour ses œuvres les plus importantes. Les Adagia, un trésor de proverbes, sentences, citations, petits essais etc., étaient le livre clé du XVIe siècle parce qu’il actualisait l’Antiquité et mettait la sagesse classique à la disposition de tout un chacun.
L’édition critique du Nouveau Testament de 1516 fut la première publication imprimée du Nouveau Testament. Érasme était d’avis qu’une lecture philologique fiable de la bible ferait sonner plus haut et plus clair la Parole vivante. Son édition tint bon jusqu’au XIXe siècle.
 Le musée de la Maison d'Érasme à Andelecht (Bruxelles).
Le musée de la Maison d'Érasme à Andelecht (Bruxelles).Prenons par exemple ses Colloquia, qui de pair avec l’Éloge, ont le mieux bravé les siècles. Il était passé d’un simple manuel scolaire avec des dialogues en latin entre écoliers à un vaste ouvrage avec des dialogues portant sur toutes sortes de sujets, truffé de réflexions philosophiques et de critiques sur la société : bref, un large éventail d’essais et de chroniques.
Et puis, la tolérance. Érasme tente d’être tolérant sur le plan religieux, mais cette tolérance venait d’être mise à rude épreuve par le schisme dans l’Église catholique, à laquelle il voulait rester fidèle, malgré toutes ses critiques. « L’essence de notre religion c’est paix et concorde : ce qu’on ne peut aisément maintenir qu’à la condition de ne définir qu’un tout petit nombre de points dogmatiques et de laisser à chacun la liberté de se former son propre jugement sur la plupart des problèmes… », dit-il dans une lettre datant de 1523. Trois ans plus tard, la faculté théologique de Paris censure ce passage. Un siècle plus tard, Grotius et les « Régents » hollandais suivraient pourtant cet Érasme-là : pour eux, la « tolérance » et l’« accommodation » étaient plus importantes que la « définition » et la « décision ». Érasme avait sa statue, mais on y ferait dorénavant plus référence qu’à ses livres.
Ainsi, la teneur de la tolérance est toujours définie par l’environnement, le contexte. Et ceux-ci sont radicalement autres qu’au début du XVIe siècle. La tolérance est une hypothèse quotidienne : elle n’existe que lorsqu’elle fonctionne. Elle ne fonctionnait pas en 1539, trois ans après la mort d’Érasme, lorsqu’une femme anabaptiste fut noyée en public dans le canal du Schie rotterdamois, près de la porte de Delft. Elle ne fonctionnait pas plus au XVIIe siècle, lorsque, dans la même ville, un « sodomite » connut le même sort. Elle ne fonctionnait pas non plus quand à l’automne de l’an 2000, l’opéra Aïsja fut annulé à Rotterdam.
Le libretto se focalisait sur Aïcha, la jeune femme de Mahomet. L’écrivaine du libretto et le metteur en scène étaient d’accord pour que le prophète lui-même ne soit pas représenté sur la scène. Finalement, le projet fit naufrage pendant les répétitions, non pas parce qu’il peignait un portrait incorrect ou préjudiciable d’Aïcha, mais simplement pour le fait qu’on n’y ferait le portrait.
Comment faire conjuguer la liberté d’expression et la liberté artistique avec le respect pour l’opinion d’un autre ? Il est clair que la tolérance d’Érasme ne nous mène pas loin, face à ce dilemme. Il était un homme de son temps, peut-être pas de tout temps.






