«Honingeter» de Tülin Erkan: s’exercer à dire adieu
Dans son premier roman Honingeter (Mangeur de miel), Tülin Erkan évoque la recherche du mot juste et la difficulté à dire adieu à des lieux ou des personnes, même quand on ne se sent jamais tout à fait chez soi nulle part.
Un décor peut parfois s’avérer tout aussi crucial pour un roman que les personnages ou l’intrigue. Souvent, la première chose dont on se souvient lorsqu’on repense à un livre est le lieu où se passe le récit. C’est le cas de Honingeter, le premier roman de Tülin Erkan (°1988), dans lequel le décor est absolument déterminant. Le lecteur se voit propulsé dans le hall de l’aéroport d’Istanbul, où se déroule toute l’histoire, hormis les rêves et souvenirs des personnages.

© Bloovi
Cet aéroport est un «endroit où les gens fondent comme de la cire», écrit Tülin Erkan dans les premières lignes, et où ils «se figent instantanément lorsque la voix de l’interphone prononce le numéro de leur vol ou annonce un énième retard». Le ton est tout de suite donné. D’après Tülin Erkan, l’aéroport est un lieu où le fait de s’égarer s’élève au rang d’art, car tout le monde est contraint d’emprunter les mêmes itinéraires.
Honingeter raconte l’histoire de Sibel, Ömer et Wernicke, trois personnages qui tentent d’ériger l’égarement en art, et tâchent peut-être aussi de disparaître eux-mêmes. Ils fuient, et dans ce but, ils traînent constamment au même endroit. Car en parallèle, ils semblent aussi chercher quelque chose, bien que nous ne sachions pas toujours quoi.
Agent de sécurité, Ömer passe ses journées à scruter des images de vidéosurveillance sans jamais rentrer chez lui. Quant à Sibel, elle rate tous les jours son vol pour Bruxelles. Ömer se met à suivre ses faits et gestes sur ses écrans, mais aussi en vrai. Elle ressent sa présence. Ou bien la devine-t-elle à travers les voyants rouges des caméras?
Tülin Erkan raconte l’histoire d’Ömer et de Sibel dans des chapitres distincts, en suivant leur point de vue respectif. Le lecteur a parfois besoin d’un peu de temps pour savoir à qui il a affaire, ce qui fait sens dans un livre évoquant des âmes qui se cherchent. On devine que tous deux finiront par se rapprocher, même si ce n’est pas forcément de la manière dont l’imagine le lecteur.
Tandis qu’Ömer et Sibel se suivent en prenant garde de ne pas s’importuner l’un l’autre, Wernicke fait son apparition. Il est pilote, mais n’a plus le droit de voler, même s’il tente avec angoisse de le dissimuler à Sibel. Elle joue le jeu. On ne sait pas très bien quel est le problème de Wernicke, même s’il a de plus en plus souvent besoin de chercher ses mots, ce qui semble indiquer des troubles neurologiques. Évidemment, le prénom Wernicke n’a pas été choisi par hasard.
Une sorte de relation se tisse entre les trois personnages, sans qu’elle soit exprimée ou mise en mots. Un vieux chien qui vit dans l’aéroport se charge de faire le lien entre eux. Personne ne pose de questions difficiles, chacun tolère la quête laborieuse de l’autre, une quête de mots, d’un endroit où se sentir chez soi.
Erkan écrit dans un style cinématographique, par scènes, sans trop en dévoiler
Tülin Erkan émaille son histoire de souvenirs, ce qui nous permet de découvrir peu à peu pourquoi ces personnes se retranchent ainsi dans l’aéroport. Ömer pense à son village natal en Turquie, mais aussi aux mines de Winterslag, et à la femme et aux enfants qu’il a laissés là-bas. Sibel songe aux études de vétérinaire qu’elle a interrompues, à son père disparu très tôt de sa vie, aux vacances chez ses grands-parents turcs. Quant à Wernicke, il se remémore les villes où il s’est rendu en avion.
Nous apprenons ainsi à les connaître un peu tous les trois, même si Tülin Erkan nous donne la possibilité de combler à notre guise les trous dans la vie et les récits de ses personnages. Elle écrit dans un style cinématographique, par scènes, sans trop en dévoiler. Elle laisse beaucoup de place à l’imagination des lecteurs, qui ont toute latitude pour rêvasser à loisir entre les chapitres.
Les quelques vers tirés de «Ne me quitte pas» de Jacques Brel, cités en épigraphe, le suggèrent déjà: ce roman parle d’adieux difficiles, de la recherche d’un endroit où l’on se sent chez soi, physiquement ou à travers la langue. «Ensemble, nous sommes déracinés», soupire Sibel à l’attention du chien de l’aéroport avec lequel elle passe des journées entières, et dans la niche duquel elle dort la nuit, en écoutant les battements de son cœur.
C’est aussi un livre qui parle des regards que nous portons sur les autres et que les autres portent sur nous, de la tentative d’oublier, mais aussi de se faire oublier, en tant que mot, fille ou père.
Avec le temps, les trois personnages finissent par espérer que les autres resteront, même s’ils savent que c’est impossible et que la fin approche. Une tempête de neige les force à rester encore un peu ensemble, laborieusement, mais au bout du compte, l’adieu est inévitable.
Tülin Erkan, Honingeter, Pelckmans, Kalmthout, 2020
Terminal 226
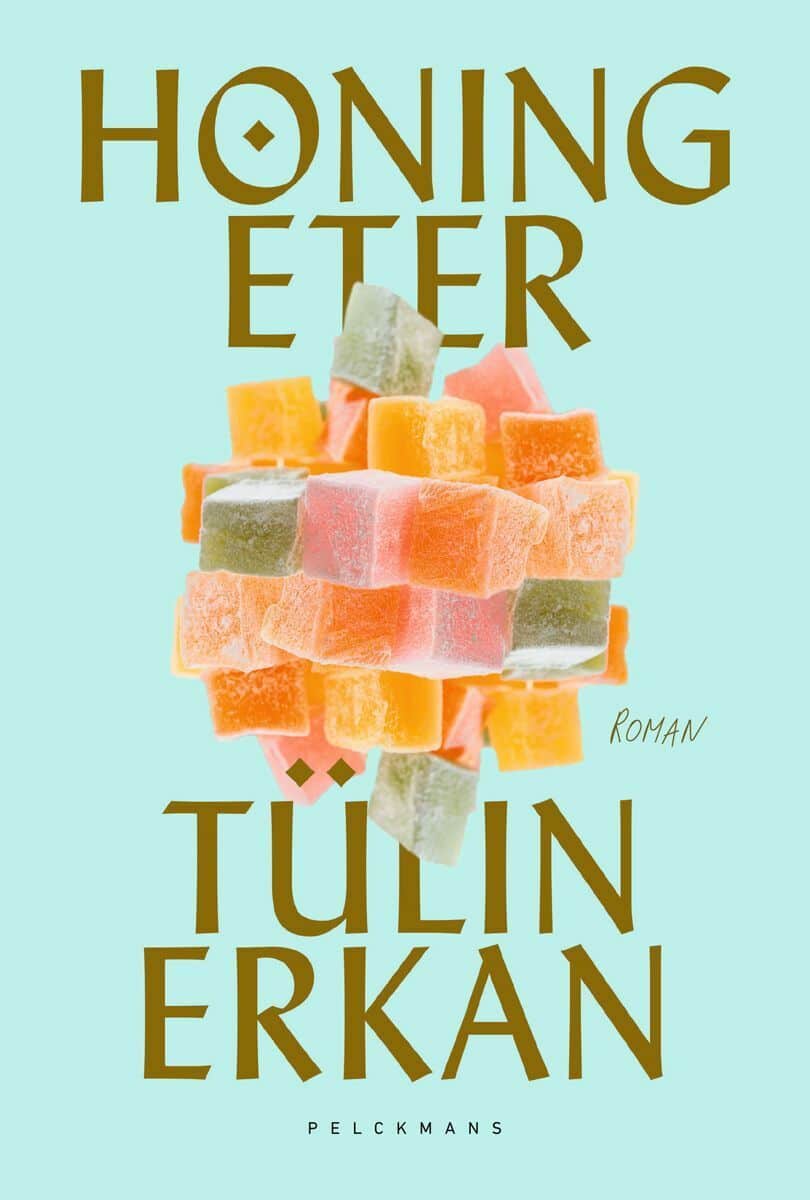
Je me demande si les escalators oublient les pas. Et jusqu’où ils devinent la pointure, le poids, la destination de celles et ceux qui les empruntent pour monter ou descendre. S’ils retiennent ces informations, en vue d’une prochaine fois. Voilà un bon moment que je suis installée ici pour le découvrir – 572 passants, pour être précise. Je consigne scrupuleusement leur nombre sous forme de bâtons dans mon carnet, afin de garder une trace de tous ces passages. Je garderai une trace de tous ces passages aussi longtemps qu’il le faudra. C’est ici que je voudrais me pétrifier et ravaler tous mes adieux, enfin, pour toujours et à jamais. Je tourne la tête à gauche et fixe, entre les passagers, les néons et les reflets déformés, la lune en forme de croissant qui, quand le ciel s’assombrira tout à l’heure comme du papier buvard, illuminera les cimes enneigées au loin. Autrefois des volcans actifs, couvant aujourd’hui sous la cendre jusqu’à ce qu’une plaque tectonique se décide à remuer de nouveau. Pendant ce temps, Istanbul bouillonne comme du magma.
Tout est lent dans un aéroport, peut-être parce que tout se répète en boucle à l’infini: les gens en partance, les tapis roulants déversant les bagages, cet escalator. Pour recommencer encore et encore. Il y a 572 passants de cela, je suis allée m’asseoir en face de l’escalator, parce que sa cadence me rassurait. La mécanique avale les marches, les recrache et se regonfle dans un cliquètement sourd. Moi aussi, j’aimerais pouvoir me regonfler ainsi.
Ça a commencé il y a longtemps: je perdais mes mots. Ou plutôt, je les ravalais sans arrêt. Quelque chose en moi refusait de les prononcer. Alors ils bouillonnaient dans mon ventre et remontaient jusqu’au niveau de mon larynx. Là, ils trébuchaient, restant suspendus au voile de mon palais, jusqu’à ce que je ne parvienne plus à expulser que de l’air. Parfois, les mots qui tentaient de jaillir vers la surface étaient si nombreux qu’ils se nouaient en un nœud coriace, mettant à rude épreuve les parois de mon pharynx. Comme quand on essaie d’avaler une trop grosse bouchée de pain rassis. J’aurais voulu pouvoir vomir l’écœurante bouillie verbeuse, en être débarrassée, tout simplement. Pendant mes études, ça ne se remarquait pas trop. Je me cachais derrière des termes scientifiques en latin et la taxonomie propre à la médecine vétérinaire, une autre sorte de langage, qui me permettait surtout de convaincre les enseignants à l’écrit. Je ne pouvais parler librement que lorsque j’étais seule avec les animaux, au laboratoire. Couiner avec les souris, coasser avec les grenouilles, grogner avec les chiens.
De nos jours, en présence d’autres personnes, j’arrive de temps à autre à faire remonter un mot sur le bout de ma langue. Ça me chatouille si fort que le mot trop impatient sort trop tôt, en saccades. J’ai lu un jour qu’il est impossible d’avaler sa langue. Cela me rassure.







