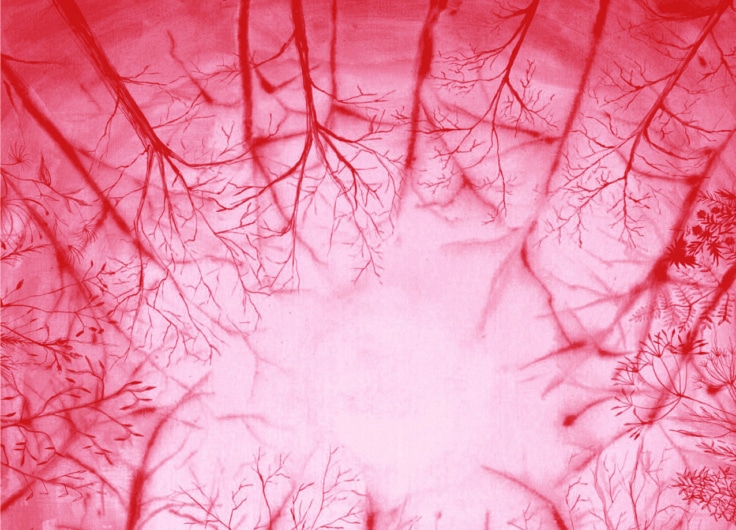La démence dans la littérature néerlandophone: jusqu’à ce que même la langue se fissure
Combien de fois n’a-t-on pas cité le vieillissement comme l’un des grands défis de notre société de demain? Mais comment vieillit-on? Beaucoup craignent surtout l’apparition des troubles de la mémoire. Ceux-ci surviennent parfois de manière subite, mais le plus souvent c’est insidieusement qu’ils grignotent du terrain. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de l’outil par excellence permettant de décrire le processus, la langue. Regard sur quelques titres sélectionnés parmi l’éventail de romans néerlandophones évoquant la démence.
Il est indéniable que nous devenons de plus en plus vieux. L’espérance de vie moyenne dans les Plats Pays n’a cessé d’augmenter, atteignant presque 80 ans pour les hommes et plus de 83 ans pour les femmes. Les baby-boomers d’autrefois ont commencé à profiter de leurs vieux jours.
Ce phénomène nécessite bien entendu une littérature adaptée. Ces dernières années y ont amplement pourvu. Citons notamment la série de journaux intimes humoristico-fictionnels d’Hendrik Groen, dont les titres primés Le Journal intime d’Hendrik Groen et Tant qu’il y a de la vie. Dans ces romans, composés de passages courts d’une apparente légèreté mais surtout d’une parfaite franchise, Hendrik Groen invite le lecteur à suivre les hauts et les bas de la vie dans une maison de retraite d’Amsterdam.
Comme dans la vie réelle, cependant, Hendrik Groen souffre de maux toujours plus nombreux. Au fil des tomes, l’homme perd de plus en plus la mémoire. Heureusement, les journaux intimes lui sont d’un précieux secours: il peut y relire ce dont son esprit a perdu le souvenir.


Le succès littéraire des heurs et malheurs d’Hendrik Groen montre le besoin qu’a le monde néerlandophone d’expériences de lecture liées au vieillissement. La popularité de Ma (Maman), où le commentateur sportif Hugo Borst décrit les soins qu’il prodigue à sa vieille mère démente, en est un autre indicateur.
Ce n’est guère surprenant si le thème de la perte de mémoire trouve un écho chez autant de lecteurs: avec le nombre croissant de personnes âgées, le pourcentage des seniors souffrant de démence augmente également. Les personnes atteignant l’âge de 80 ans ont 25 % de risques d’être touchées par la maladie d’Alzheimer; chez les plus de 90 ans, les risques sont même de deux sur cinq.
Mémoire enneigée
 J. Bernlef (1937-2012)
J. Bernlef (1937-2012)© DR
La littérature s’avère le moyen idéal pour décrire ce processus d’oubli. Le roman néerlandophone de loin le plus connu sur la démence est Chimères de J. Bernlef (1937-2012), dont le protagoniste Maarten Klein perd lentement mais sûrement le contact avec la réalité. L’homme a de plus en plus de mal à distinguer le présent du passé. À la retraite depuis de nombreuses années, il croit tout à coup devoir se rendre au travail. Il s’éloigne également de plus en plus de sa femme Véra, jusqu’à ne plus la reconnaître du tout.
Le présent offrant de moins en moins de prise, les personnes séniles se retirent dans le passé. Plus les trous prennent de l’ampleur dans la mémoire de Maarten, plus il repense à sa vie d’avant, encore épargnée par l’amnésie. Ses souvenirs de guerre, en particulier, rejaillissent avec une grande clarté.
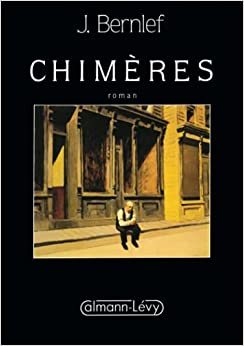
La nature aussi continue de fasciner Maarten. Régulièrement, il se tient à la fenêtre, observant un écureuil en quête de nourriture, tandis que la neige tombe sans discontinuer – un thème récurrent dans le roman et une métaphore pour la mémoire toujours plus enneigée de Maarten. Ce n’est pas un hasard si le roman s’ouvre sur la phrase «C’est peut-être à cause de la neige que je me sens déjà si fatigué dès le matin.»
La démence est indissociable de certains simulacres, comme le montre Bernlef dans Chimères. La peur que l’entourage remarque tous ces ratés de son cerveau le conduit à une surcompensation: régulièrement, Maarten se fâche contre sa femme lorsque c’est elle qui ne se souvient pas d’un événement précis, ou se cache derrière l’excuse de n’avoir jamais eu bonne mémoire. Le fossé entre lui et les autres ne s’en creuse que davantage.
Mémoire externe
Le corps tient un rôle très particulier dans la déchéance qui accompagne irrémédiablement la démence. Dans le cas de Maarten, il forme une sorte de mémoire externe, déconnectée de l’esprit qui se délite. Il en résulte que les pieds d’une personne amnésique sont encore tout à fait capables d’exécuter des pas de danse appris plusieurs décennies auparavant, ou que les mains trouvent encore leur chemin sur les touches d’un piano. Dans Chimères, ce sont d’ailleurs des moments de répit dans un récit qui tire toute sa tension de l’inéluctable naufrage.
Bernlef montre avec justesse le rôle crucial que joue le langage dans ce processus. Maarten cherche ses phrases de plus en plus longtemps et sent parfaitement quand il se trompe de mot, tout en étant incapable de mettre le doigt sur le bon. Les dernières pages de Chimères sont célèbres: de plus en plus de blancs, de moins en moins de phrases complètes et de plus en plus de points de suspension, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de la langue. Chimères se distingue de nombreux autres romans ayant pour thème la démence par le fait qu’il s’attache au point de vue du malade. Cela lui permet de nuancer l’image que l’on se fait bien souvent des personnes atteintes d’Alzheimer: Maarten est bien plus qu’un personnage hagard, et nombreuses sont encore les choses qui font que sa vie vaut la peine d’être vécue jusqu’au bout –notamment ce flot ininterrompu de souvenirs d’un passé lointain.
Attaché à son fauteuil
 Jeroen Brouwers (1940-2022)
Jeroen Brouwers (1940-2022)© DR
Un roman à succès plus récent sur la démence est Client E. Busken de l’écrivain Jeroen Brouwers (1940-2022), qui reste à ce jour le seul auteur néerlandophone à avoir remporté le prix Femina Étranger. Client E. Busken se penche sur une journée de la vie d’un vieil homme dans une institution fermée, attaché à son fauteuil roulant. Mutique face au monde extérieur, il continue de ruminer dans sa tête.
Tout ce qu’il voit et vit le ramène de manière directe ou indirecte à ses propres souvenirs. La tenue des soignants, qui ne lui permet pas de déterminer si ce sont des hommes ou des femmes, lui rappelle cette phrase de sa mère qui lui avait dit qu’elle aurait préféré une fille. Le fait que l’institution où il est contraint de séjourner est uniquement constituée de souvenirs peut même être déduit de son nom: la Maison Madeleine, sans aucun doute en référence à la fameuse scène de la madeleine de Proust, qui fait resurgir chez le personnage principal de la Recherche un flot de réminiscences.

Au début, M. Busken témoigne encore d’une excellente maîtrise de la langue: tel un moulin à paroles, il débite dans sa tête de magnifiques phrases pleines de rythme. De plus en plus souvent, cependant, le lecteur le surprend à utiliser un mot qui ne cadre pas dans le contexte. Le contenu de son discours est, lui aussi, de moins en moins crédible: Busken prétend être neurochirurgien, «météorologue polaire», paléogénéticien», «stratège à l’État-major», «cryptozoologue», peintre, compositeur et écrivain de renom.
Il peut s’agir d’un comportement destiné à contrebalancer la monotonie grandissante du monde qui l’entoure. Ses inventions apportent un peu de couleur à sa vie désormais privée de relief. En même temps, toutes ces réalités enchevêtrées sont symptomatiques de la perte de contrôle de Busken sur son propre cerveau. Tout comme sa langue virtuose semble de plus en plus souvent échapper à sa volonté, les souvenirs qu’il exprime à l’aide de ces mots s’avèrent également de moins en moins fiables.
L’expérience de l’entourage
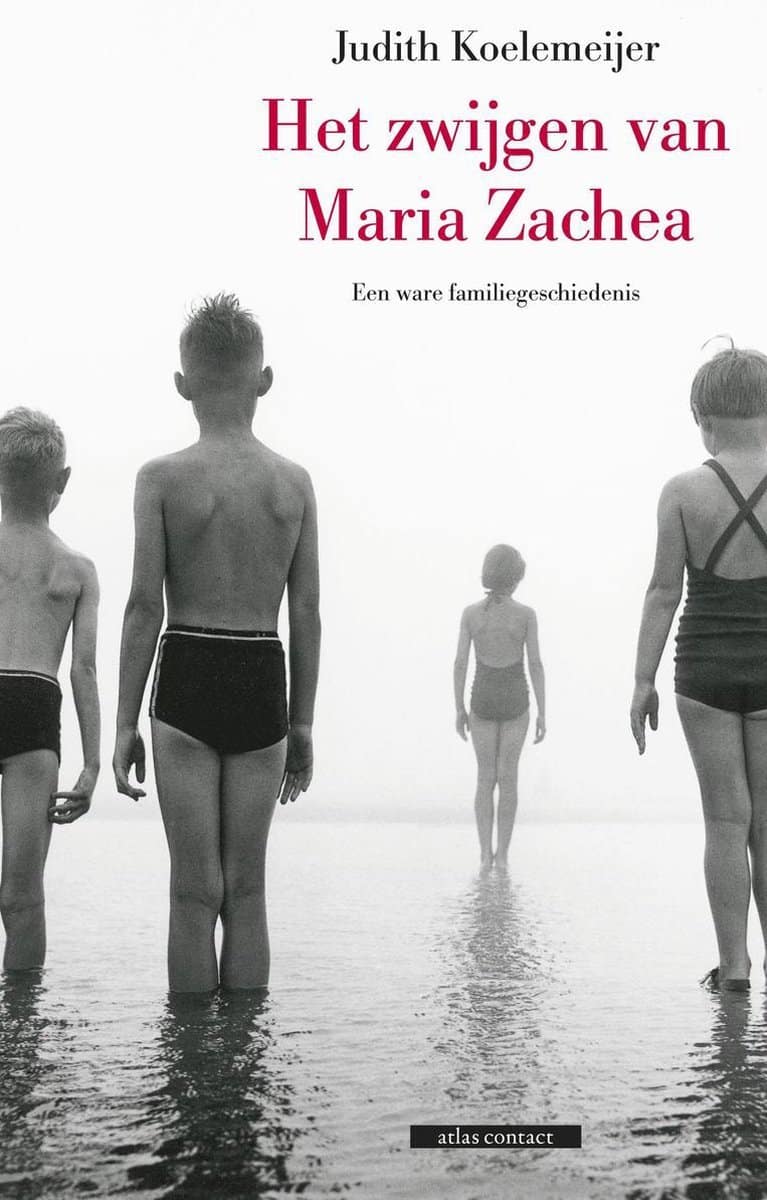
Dans la littérature néerlandophone, la personne démente est loin d’être toujours au centre du récit; de même, l’amnésie ne joue pas toujours le rôle principal. Souvent, elle n’est qu’une composante d’une dégénérescence plus longue, comme dans le cas de Het zwijgen van Maria Zachea (Le Silence de Maria Zachea) de Judith Koelemeijer, où douze enfants s’occupent de leur mère qui, frappée par une hémorragie cérébrale, passera les huit années suivantes en silence, assise à la fenêtre. L’accent n’est pas mis sur la déchéance de cette femme –dans laquelle on discerne également des traces de démence–, mais sur l’image très différente que chacun des enfants a gardée de cette mère.

Parfois, il n’est même pas évident que l’on ait affaire à Alzheimer. C’est par exemple le cas de La Langue de ma mère où l’auteur Tom Lanoye, maintes fois traduit en français, dresse un portrait de sa mère Josée Verbeke. Après une vie riche et mouvementée, Josée est victime d’un AVC et se retrouve dans un établissement de soins. Tout comme les personnages précités atteints de démence, elle est privée de langage. Ses mots et sa syntaxe deviennent approximatifs.
Dans cette histoire, les antécédents de la malade comme ceux du narrateur rendent cette perte d’autant plus tragique. Non seulement la mère de Tom Lanoye était une comédienne amatrice, s’appuyant sur le pouvoir de la parole, mais il est également extrêmement douloureux pour Lanoye, en tant que fils, de perdre sa plus grande arme face à celle qui lui apprit à parler. La communication entre eux s’enraye.
«Sans laisser de trace»
Par sa capacité à mélanger le passé et le présent, à enchevêtrer la vérité et le fantasme, à fissurer le langage jusqu’à ce qu’il rompe, la littérature s’avère le moyen idéal pour dépeindre le déclin qu’entraîne la démence. Le lecteur des romans ci-dessus se rendra compte à quel point notre mémoire assure la cohérence de notre vie, nous évite de recommencer sans cesse le moindre de nos actes ou de nos raisonnements. La mémoire donne à notre monde le sens qu’il a pour nous. Ou, comme le formule Maarten, le personnage principal dans Chimères: «Pour voir quelque chose, il faut d’abord être capable de le reconnaître. Sans mémoire, on ne peut que regarder. Et le monde nous traverse alors sans laisser de trace.»
Les rires de la salle: un extrait de «Chimères» de J. Bernlef
Allez, lève-toi, toi… va inspecter ce piano de plus près… il s’approche des marches sur le côté de la scène… les monte avec peine, en trébuchant… des touches qui s’enfoncent toutes seules… tantôt dans les médiums, tantôt pour une rengaine qui s’envole dans les aigus… peut-être qu’elles peuvent aider tes doigts… peut-être leur réapprendre à jouer… à jouer par cœur… la bienheureuse sensation que c’est ton corps qui te joue… que tu es devenu musique… il s’assoit sur la chaise devant le piano et sent les touches heurter ses doigts… elles te repoussent… te rejettent… ne veulent plus rien savoir de toi et le chef de cantine te soulève en ricanant, te remet debout et voudrait que tu l’aides à dresser tous ces vieillards assis à leurs tables, là en bas, à les faire chanter au rythme de ce piano criard qui joue tout seul et qui derrière ton dos attaque Home on the range et il voit l’enthousiasme puéril de ces faces grandes ouvertes, si contentes de pouvoir faire ensemble la même chose sur l’ordre de cette machine à musique.
Te sauver… filer d’ici et tu cherches à tâtons une issue entre les plis épais d’un rideau de fond de scène… les rires de la salle dans les oreilles, tu cherches à tâtons… tu te raccroches aux plis… avances en t’agrippant à l’étoffe jusqu’au moment où tu trouves la sortie et tu t’arrêtes en haletant dans l’obscurité où tu entends encore le piano mais étouffé et aussi le chant de plus en plus faible et déficient… c’est la sortie qu’il cherche… à la bonne heure… et il se retrouve près d’un autre escalier que tu descends à reculons, à quatre pattes, ou bien tu culbutes, on ne sait pas trop et puis tu vois la lumière allumée à l’entrée d’un couloir carrelé de pierre grise avec de hautes fenêtres grillagées et tu passes devant une rangée de toilettes sans portes… il pénètre alors dans une pièce où sont de grands lavabos et des robinets… l’abreuvoir… enfin, de l’eau… boire… continue à boire… rincer… rincer… rincer… coule… je dois couler… m’allonger sous l’eau et m’écouler… partir en m’écoulant… pourquoi privent-ils ce corps de sa source, ces gardiens, pourquoi est-ce qu’ils le sèchent et l’éloignent de l’eau?
Ils l’amènent, le corps, dans une pièce pleine de lits… ils le déposent sur le bord d’un de ces lits… ils le déshabillent… ils lui passent un pyjama qui ressemble à ceux des autres avec leurs grosses têtes à moitié chauves au regard fixe appuyées contre les hauts oreillers blancs et toutes tournées de son côté… ils enfoncent une pilule dans sa gorge… ils y versent de l’eau comme dans un entonnoir… ils le couchent dans le lit… ils longent tous les deux la rangée des lits… ils ne disent rien jusqu’à la porte puis crient en même temps bonne nuit good night qu’ils crient et puis c’est le noir.
Ça respire de partout… ils sont tous venus pour dormir ici ensemble une dernière fois… qui avec qui ça n’a plus d’importance… plus de noms… plus de visages… plus qu’un souffle… des soupirs… tous des gens qu’il connaissait quand ils vivaient encore… les uns comme les autres… les connaissait personnellement… elle se trouve quelque part au milieu d’eux… la chercher… c’est sa main que nous devons chercher… ça prend du temps… ça dure toute une vie… expirer et soupirer et gémir et geindre et grogner et ronfler… sa main viendra vers toi… ici… prends d’abord cette main qui s’agite dans le noir et fouille à sa recherche… saisis-la doucement… calme-la… maintenant tu n’as plus rien à tenir toi-même… elle va le faire pour toi… elle te porte… je te porte… mon petit garçon à moi… toute la longue nuit, la nuit qui fait peur je vais te porter jusqu’au jour…
Quand le jour est déjà là good morning et quelqu’un dit… chuchote… la voix d’une femme et tu écoutes… tu écoutes les yeux fermés… écoute seulement sa voix qui chuchote… que la fenêtre est réparée… celle où on avait cloué cette vieille porte… on a remis une vitre… on peut regarder à travers… regarder dehors… le bois et le printemps qui a presque commencé… qu’elle dit… qu’elle chuchote… le printemps qui est sur le point de commencer…
Traduit du néerlandais par Philippe Noble. Traduction revue pour Septentrion d’un extrait de Chimères (titre original: Hersenschimmen), éditions Calmann-Lévy, Paris, 1988.
Seulement assis ou allongé: un extrait de «Client E. Busken» Jeroen Brouwers
… tout d’un coup, je pense à ma mère. Je ne pense jamais à ma mère, morte il y a des décennies. Depuis, j’ai atteint un âge plus avancé que le sien. Je voulais dire… je voulais dire quelque chose? Que me voici en dehors, au-delà du temps où nous étions encore tous deux là, ma mère et moi, et qu’il n’y aurait aucune honte à ce que je l’aie oubliée. Je ne l’ai pas oubliée; simplement, je ne pense jamais à elle. En un flash, son image m’est passée par la tête et a été instantanément évacuée. C’est ce que je voulais dire, je crois. Encore capable de trouver mes mots. Est-ce vraiment ma mère qui, telle une étincelle d’éclair est apparue dans mon esprit, et pas quelqu’un d’autre, – une autre femme? En robe d’été, dans la chaleur fumante du soleil, sur une plage où je me trouve, moi aussi. Elle a les bras tendus le long du corps, les doigts en extension. Toute la force de ses épaules et de ses bras afflue dans ces doigts, qu’elle tient écartés, pointés vers le sable, sur lequel son ombre est réduite à un cercle, autour de ses pieds. Maigre comme un squelette dans cette indienne à petits carreaux d’un jaune et d’un vert délavés. Elle étire ainsi ses doigts lorsqu’elle est en colère et avant de les serrer convulsivement en deux poings agités de tremblements. Il faut alors déguerpir. En tout cas, veiller à ses distances, car elle va frapper. Ce devait donc bien être ma mère, évacuée de ma pensée comme une déjection, mais elle avait le visage, la tête, la stature de quelqu’un d’autre, qui n’était pas nécessairement du sexe féminin. Vous pouvez fumer tranquillement vos bâtons de nicotine ici, me crie sœur Morton. «Vos tiges à cancer» pourrait-elle dire, mais on ne parle pas de cancer ici. Ne jamais dire cancer. Elle lève la tête, fixant ses regards là où l’on ne peut voir le ciel au-dessus des arbres. Les cimes des sapins remuent en tous sens sous un vent qui souffle depuis des jours – si fort hier et accompagné d’une pluie si virulente que tout le monde a dû rester à l’intérieur. Aujourd’hui le temps restera sec, affirme-t-elle. Ils prévoient du soleil. Ici, en bas, il n’y a pas de vent. Les freins sont-ils calés à fond ? Elle vérifie. Oui – cette voix de virago – vous êtes bloqué. Le fait est. Pour être bloqué, je le suis. Plus bloqué que les roues du fauteuil roulant, qu’elle a verrouillées, quelque part dans mon dos, hors de ma portée. Ces roues vont se remettre à tourner normalement, une fois débloquées. Moi, je ne suis pas comme ces roues car je ne peux plus rien faire, que voulez-vous. Seulement me tenir assis ou allongé. Et observer. Penser. Ruminer. Broyer du noir. Chercher mes mots. Voir des couleurs là où elles sont absentes, où, tout du moins, là où les autres ne les voient pas. À l’aide d’une sangle qui passe autour de ma taille, elle m’a immobilisé dans mon fauteuil. Il m’est impossible de défaire moi-même la boucle qui me comprime le nombril. Ma rage et ma révolte sont ramollies à coups de piqûres et de cachets. Seuls bougent mes mains et avant-bras. Comme j’arrivais encore à donner des coups de pied, ils ont fini par attacher mes jambes au fauteuil. Vous avez vos clopes? Briquet? Le sifflet est là, dans la poche gauche de votre chemise, Monsieur Busken. Si vous sentez que ça presse, soufflez dedans aussitôt. Afin d’éviter qu’un petit accident ne vienne à se reproduire. Elle ne se rend pas compte qu’elle crie, je crois. Elle est belle à voir, comme l’est cette autre femme, sur ce tableau, mais ses décibels me perturbent. Elle me regarde. Eh bien, Monsieur Busken? Vous m’entendez. Monsieur Busken? Vous pourriez répondre. Voilà qu’elle m’effleure la tempe, me donne, de sa fine main fermée une tape sur l’oreille, légère mais bien sensible – un petit coup.
Traduit du néerlandais par Bertrand Abraham. Extrait de Client E. Busken (titre original: Cliënt E. Busken). La traduction française paraîtra bientôt aux éditions Gallimard de Paris.
Ne plus jamais se taire: extrait de «La Langue de ma mère» de Tom Lanoye
Après le questionnement, la dernière scène. Le véritable adieu. La dernière fois que je l’ai vue respirer. Elle est couchée dans une chambre inondée de soleil et pourtant froide, à cause de l’air conditionné. Blancs les draps, blancs les rideaux, blancs les murs, blancs les cheveux sur l’oreiller blanc. Ses yeux sont fermés, son visage est maigre, sa bouche sans dentier est vilainement pincée, son nez est déformé par la sonde. Elle ne respire pas, elle râle. Les médecins m’ont affirmé qu’un tel râle est normal, pas douloureux et même inévitable. Nos poumons se remplissent d’eau. Dans notre essence, nous sommes des poissons avec des prétentions. Je prends place à côté d’elle, une cuisse sur le lit. Elle ne le remarque pas, elle continue à râler. Personne ne sait combien de temps encore elle va tenir. Ce cœur entêté, indocile et fort, il ne veut pas lâcher prise, il continue à battre. Ses mains sont posées sur le drap. Je glisse un doigt sous une paume, espérant que ses doigts vont se refermer doucement en un poing, ne serait-ce que par réflexe. Je veux croire que je sens un frémissement, mais le poing ne se serre pas. J’aperçois un tout nouveau petit poil sous son nez. Oserais-je l’arracher? Où vais-je trouver une pince à épiler? Essayerais-je avec mes doigts? Mes ongles ne sont-ils pas trop courts? Puis une des infirmières entre. Ce sont des femmes qui font leur métier méticuleusement. Elle vérifie le sac de plastique plein de liquide, puis la sonde, puis le pouls, puis un œil – elle tire avec respect la paupière vers le haut, je vois pour la dernière fois l’iris bleu-gris. Finalement l’infirmière, qui m’adresse un sourire de bonhomie et de compassion, sort de la poche de sa blouse deux gants de latex. Elle les enfile d’un geste routinier. Elle me jette encore un petit regard de doute. Puis elle fait tout de même son travail. Elle glisse précautionneusement deux doigts d’une main entre les mâchoires de la patiente et les écarte. De l’index de l’autre main elle libère, de l’endroit même d’où était issue la langue que j’ai apprise, un petit peu de mucus et l’essuie dans un mouchoir de papier. Et c’est là, c’est alors que je me suis juré que dorénavant j’aurais une seule vocation, un seul but, un seul putain d’impératif choisi par moi-même, parce que je ne suis pas capable de grand-chose d’autre, parce que je n’ai rien appris d’autre et parce que je ne crois en rien d’autre. Et cela est: où et quand j’en verrai l’occasion, je lutterai contre le silence par ma voix, je tenterai de contester le vide par ma parole, j’essaierai de me battre contre tout le papier du monde avec ma langue. Que ceci soit ma rébellion, ma révolte, contre le mucus, contre le râle d’agonie. Laissez-moi au moins cela comme mutinerie. Qu’il n’y ait plus une seconde, plus une feuille, plus un livre qui ne parle en cent mille langues, qui n’exalte le vocabulaire. Ne plus jamais se taire, toujours écrire, plus jamais sans parole.