«La Femme sauvage» de Jeroen Olyslaegers: Dionysos en pays scaldien
Dans son deuxième roman historique, Jeroen Olyslaegers fait revivre l’Anvers de la période autour de 1566, année funeste et mouvementée. Dans une langue à la fois lyrique et populaire, il livre un récit foisonnant qui parle d’amitié, de fraternité, de foi et de trahison.
Jeroen Olyslaegers avait démontré sa maîtrise du genre quelque peu éculé du roman historique avec WIL qu’il situait à Anvers pendant l’occupation allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Succès de librairie couronné de plusieurs prix dans l’aire néerlandophone, le roman a paru en français sous le titre de Trouble
en 2019. Après plusieurs années de travail intensif, Olyslaegers transporte lecteurs et lectrices encore plus loin en arrière dans le temps avec La Femme sauvage.
Nous sommes à Amsterdam, en 1577. Beer, aubergiste et affable quinquagénaire, jette un regard rétrospectif sur les événements qui l’ont chassé d’Anvers dix ans auparavant. En ce temps-là, la ville au bord de l’Escaut n’était pas seulement une effervescente plaque tournante du commerce et un creuset explosif de religions, mais aussi un important centre artistique, où florissaient peinture, cartographie, imprimerie et chambres de rhétorique. Trois des épouses de Beer sont mortes en couches. Avant de mourir, la troisième lui a donné un fils, Ward. Dès sa naissance, Ward est anormalement poilu –à croire que la femme de Beer ne s’est pas «accouplée» avec lui, mais avec «un animal sauvage». Dans cette pilosité excessive, Beer voit à la fois «un signe de Toi, là-haut» et un signe de la «sauvagerie foncière» de Ward: aucun doute, son fils est prédestiné à «quelque chose de singulier».
 Jeroen Olyslaegers
Jeroen Olyslaegers© Stephan Vanfleteren
Depuis le poste d’observation que constitue son auberge fréquentée, Beer assiste, en témoin oculaire privilégié, à l’intensification des troubles qui agitent Anvers. Parmi ses clients réguliers et bienvenus, il compte le cartographe Abraham Ortelius, l’imprimeur Willem Silvius et même, entraîné dans leur sillage, le peintre Pieter Bruegel, dit «Pierre le Drôle» – qui en un tournemain réalise une imposante peinture murale représentant Beer assoupi au milieu de singes.
Une expédition commerciale ayant tenté de rallier «les Indes» en coupant par le pôle Nord rentre sans avoir atteint son but mais chargée d’un surprenant butin: deux Skrælingar, une femme inuite –la femme animal, comme l’appelle Beer– et sa petite fille. La «femme sauvage» est offerte en présent à Ortelius, mais celui-ci la confie aux bons soins de Beer. Bien qu’ils ne puissent pas communiquer, l’aubergiste tombe peu à peu sous le charme de la quatrième femme de sa vie.
Beer fait partie d’une «Ligue de l’Homme sauvage» avec trois de ses amis: le libraire Hugo, le voyageur (et coq) aveugle Jeroom et «de Schrale» (le Sécot), personnage bouffon et grincheux qui selon la rumeur aurait servi de modèle à la Dulle Griet (Margot la Folle) de Bruegel. À la Chandeleur, ce quatuor haut en couleur défile dans les rues, Beer en «costume d’ours», avec une grande «fausse barbe en corde» et «une couronne de lierre», les trois autres déguisés respectivement en roi, en chasseur et en femme, faisant mine de chasser l’homme sauvage de la ville «pour accélérer le dégel et accueillir le printemps».
À Anvers, où règnent alors l’esprit de commerce et l’idée de progrès, les quatre amis travestis sont regardés de haut, «aux yeux des commerçants, un homme aussi bestial n’était qu’une réminiscence comique des temps anciens». Pour Beer, jouer à l’homme sauvage est «sacré», c’est « notre véritable forme à tous, le passé immémorial qui nous reliait tous». Dans la femme étrangère qui lui est échue, il voit une réponse divine à sa demande pressante d’amour: ensemble, ils sont indéniablement une image du couple de sauvages qui flanque les armoiries d’Anvers.
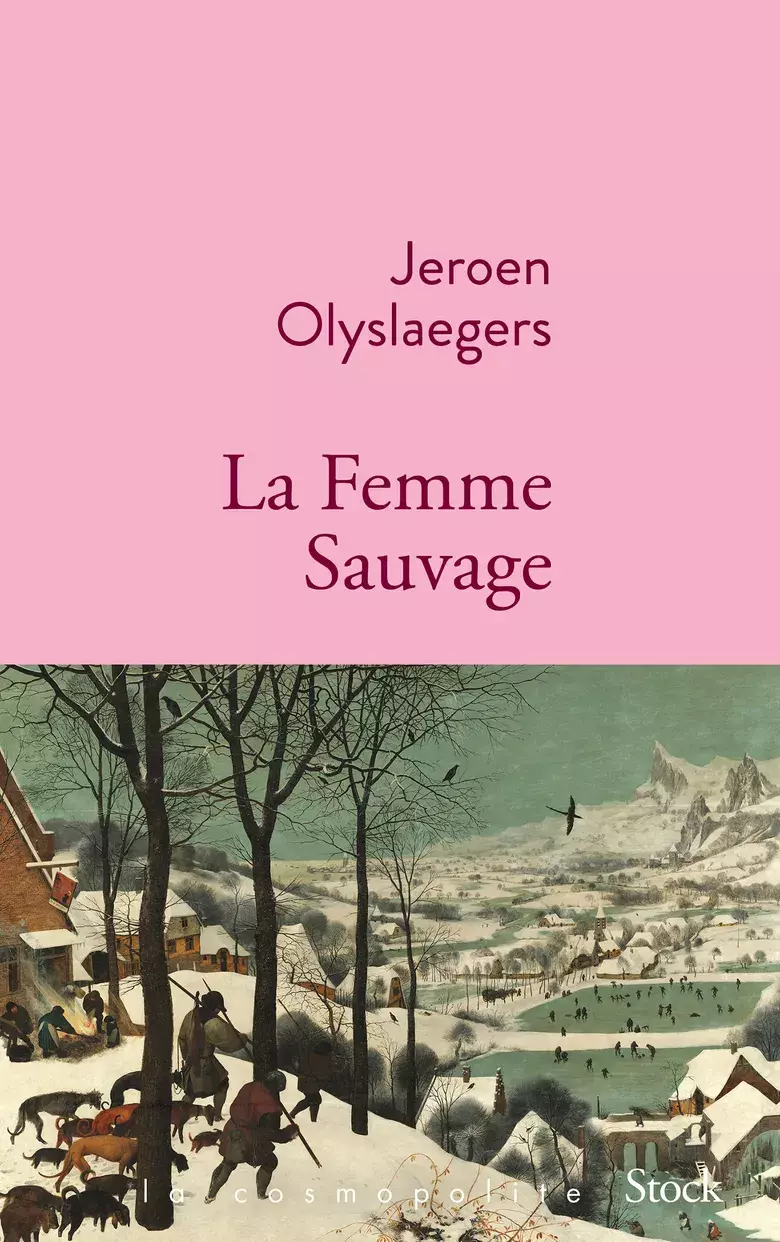
Le récit de Beer est une confession, tout comme l’était celui de Wilfried Wils dans Trouble, à cette différence près que l’aubergiste ne feuillette pas son journal, mais adresse directement ses aveux à cœur ouvert à Dieu et au lecteur. Talonné par la mort, il a le sentiment d’être maudit et se compare plusieurs fois à Job.
Depuis son exil d’Amsterdam, il tente de se réconcilier avec son passé et de rompre cette malédiction. Son récit est une voix off envoûtante, captivante, notamment grâce aux descriptions pittoresques et vivantes. Jeroen Olyslaegers est maître dans l’art d’installer une atmosphère et il sait comme personne peindre en quelques coups de pinceau un tableau particulièrement vraisemblable et évocateur d’événements historiques.
Ses descriptions du Beeldenstorm (la Fureur iconoclaste de 1566), du landjuweel (tournoi entre chambres de rhétorique) de 1561 et des premiers hagenpreken, ces «prêches derrière les haies» rassemblant les calvinistes hors les murs des villes, sont simplement grandioses, de même sa description de la harangue du «Grand Gueux» Henri de Brederode ou d’Hugo, planté avec son éventaire de livres au beau milieu de l’Escaut gelé pendant le terrible hiver de 1564.
Olyslaegers est maître dans l’art d’installer une atmosphère et il sait peindre en quelques coups de pinceau un tableau particulièrement vraisemblable et évocateur d’événements historiques
Dans l’auberge de Beer se tiennent des réunions de la Familie der Liefde (la Famille de l’Amour), une société secrète composée principalement de «personnages aisés». L’aubergiste ferme les yeux sur les activités de cette clique maçonnique, dont il ne sera lui-même jamais membre à part entière. Cela ne les empêche pas de l’obliger à effectuer diverses besognes pour certains de leurs membres, tel maître John Dee, qui profite de son séjour à l’auberge pour écrire un livre diabolique, ou le Hongrois Sambucus, personnage louche qui constitue dans la cave de Beer une bibliothèque de livres interdits. Les accords équivoques pris avec ces bandits finiront par coûter cher à l’infortuné tenancier. Ses amis le considèrent comme un traître et, en août 1567, il est contraint de s’enfuir à Amsterdam avec la femme sauvage et sa fille.
En optant à nouveau pour le roman historique, Olyslaegers se rattache explicitement à une tradition, mais non sans repousser les limites du genre. De vastes recherches ont précédé le processus d’écriture, effectuées pour la plupart par le «frère de sang» de l’auteur, Stef Franck. Les résultats de ces recherches sont rassemblés sur un site web –de ceux pour lesquels le terme «surfer» semble avoir été inventé. Si la Dulle Griet de Bruegel –qui hante aussi quelques fois Wils dans Trouble– a été l’un des premiers catalyseurs, lorsque Stef Franck a débarqué avec une représentation d’un homme sauvage inspirée de Bruegel puis, plus tard, avec une gravure anonyme montrant une version féminine du sauvage, qui plus est avec enfant, c’était évidemment une manne pour l’écrivain.
Jeroen Olyslaeger mêle habilement les faits et la fiction, sans laisser l’aspect documentaire prendre le dessus et en préservant en bel équilibre entre personnages historiques et fictifs. Il ne tombe jamais dans le piège de l’édification, et demeurant –à l’instar des Hommes sauvages qui boivent du «sang de berserker» avant d’entamer leur tournée– un fervent disciple de Dionysos, il fait la part belle à l’imagination. Le naturel des dialogues et la vérité des nombreux personnages confèrent à La Femme sauvage la grandeur d’une chronique de cour.
Mais Jeroen Olyslaegers ne serait pas Jeroen Olyslaegers sans un point de vue engagé. Beer a un solide poids sur la conscience. Il s’est rendu coupable de complicité, et s’il fuit devant les troubles qui menacent Anvers, il fuit aussi parce qu’il a honte d’avoir trahi, ses amis mais aussi la femme sauvage. Dans ses confessions, il ne cesse de se justifier, faisant montre d’une haute capacité à s’aveugler, à se tromper lui-même, et se révélant un pur «faux jeton», pour reprendre à nouveau les termes de Wilfried Wils dans le précédent roman de l’auteur.
Quand Ward demande à Beer pourquoi les membres de la Famille ne veulent pas partager leurs secrets, il lui répond que la fraternité «c’est une belle chose», mais qu’au plus profond de lui, l’homme est dominé par un «grand besoin» d’être trompé. Le choix pour l’une des épigraphes du livre de Mundus vult decipi, «le monde veut être trompé», maxime attribuée à l’humaniste allemand Sebastian Franck, semble donc tout à fait pertinent. Lorsque Beer ajoute que la tromperie est toujours tromperie de soi-même, et qu’il a fui Anvers parce que «l’union avait déjà été dépouillée de ses habits par les citoyens, bien avant que les Espagnols ne la violent comme des anges exterminateurs», la référence à la polarisation actuelle de notre société est indéniable.
Olyslaegers avait, avec Trouble, réussi son «grand roman flamand», mais il parvient encore avec La Femme sauvage à se surpasser et à se réinventer.
Jeroen Olyslaegers, La Femme sauvage, traduit par Françoise Antoine, Paris, Stock, 2024.
Lisez aussi l’entretien avec Jeroen Olyslaegers à l’occasion de la parution de son roman.









