Un enfant au sein, un livre à la main: quand les femmes écrivent sur la maternité
Dans la littérature d’expression néerlandaise, les histoires portant sur les mères ont pendant longtemps été surtout le fait d’écrivains masculins. Ces dernières années, on constate un changement et la maternité, aux différents sens que revêt ce terme, apparaît plus fréquemment à travers les yeux de femmes qui doutent, de quasi-mères, de mères qui regrettent d’avoir mis un enfant au monde ou d’autres qui sont écrivaines.
Il est frappant de constater qu’avant et après le tournant du XXIe siècle, de nombreux romans des Plats Pays ont été signés par des fils qui brossent le portrait de leur mère. On pense, par exemple, à La Langue de ma mère (1) de Tom Lanoye, œuvre dans laquelle le Flamand évoque l’AVC dont sa maman a été victime et la déchéance qui a suivi. De même, dans Quand je n’aurai plus d’ombre (2), le Néerlandais Adriaan van Dis a décrit avec brio sa mère, revenant sur de beaux souvenirs -et d’autres moins beaux- liés au caractère pour le moins singulier de cette dernière.
 Evert Pieters, Mère et Enfant, vers 1900
Evert Pieters, Mère et Enfant, vers 1900© Museum Singer Laren
Elles sont extravagantes, les mamans de ces pages fortement autobiographiques. Mais chacune n’attire, dirait-on, l’attention de son garçon que lorsqu’elle est déjà âgée, alors qu’elle décline et périclite. La vieillesse rendrait-elle ces femmes plus intéressantes, en raison de tout ce qu’elles ont vécu et de leur nature grognonne et versatile?
Devenir mère?
Contrebalançant toutes ces histoires écrites du point de vue du fils, une nouvelle perspective est apparue ces dernières années: celle de la mère elle-même. Ainsi, on apprend à vraiment connaître la maternité de l’intérieur en même temps qu’on assiste à l’émergence de sous-genres intéressants: celui de la femme qui doute d’être assez courageuse pour devenir mère, celui de la femme qui veut avoir des enfants sans en avoir la possibilité, celui de la femme qui cherche à concilier maternité et carrière littéraire…
Différents exemples illustrent toutes ces catégories. Dans le genre de la femme en voie de devenir mère ou de renoncer à le devenir, on relève par exemple le roman de Dorien Dijkhuis, Dezelfde maan (La Même Lune, 2024): alors qu’elle séjourne sur une île, la protagoniste revient sur la façon dont sa vision de la maternité a évolué au cours de la période récente.
 Jantine Jongebloed
Jantine Jongebloed© K. Keukelaar
Elle qui doutait, est aujourd’hui convaincue de vouloir un enfant, mais l’indifférence de son compagnon sur le sujet la replonge dans l’indétermination. Lentement mais sûrement, ces amoureux s’éloignent l’un de l’autre en raison de leurs visions divergentes.
Dans son essai Soms wil ik een kind (Par moments, je veux un enfant, 2023), Jantine Jongebloed éprouve un doute similaire. Elle a vécu deux grossesses extra-utérines. La première fois, elle est tombée enceinte sans le savoir, la seconde alors qu’elle désirait fonder une famille avec Maas, son compagnon. En elle, cela enclenche un processus de doute, qui – si elle vient à s’écouter vraiment – ne va toutefois pas devoir perdurer, car l’horloge biologique ne cesse de tourner.
Anxieuse, Jantine compte le nombre d’ovulations qu’il lui reste avant que Mère Nature ne ferme inexorablement les vannes. Pendant ce temps, elle philosophe. Se demandant si elle préférerait être père plutôt que mère. S’interrogeant sur notre façon d’appréhender, aujourd’hui encore semble-t-il, ces rôles et de les remplir; sur le terme «mère-à-regret» – une femme qui, rétrospectivement, aurait préféré ne pas être mère – et les raisons pour lesquelles notre société a du mal à parler de ce sujet; sur ce que ça veut dire, être une femme sans enfant.
Contrebalançant toutes les histoires écrites du point de vue du fils, une nouvelle perspective est apparue ces dernières années: celle de la mère elle-même.
Certaines femmes deviennent mères sans l’avoir demandé. D’autres, également tombées enceintes contre leur gré, renoncent à le devenir. C’est le cas de l’écrivaine Meredith Greer qui, dans Bedenktijd (Temps de réflexion, 2023), décrit comment, en plein confinement et en plein isolement, elle subit un avortement. Elle en fulmine, elle en pleure, elle en vient à réfléchir: sur la manière d’exprimer sa peine à travers l’écriture; sur la façon dont la société regarde la suppression d’une vie naissante; sur ce que cela signifie, être seule et invisible…
Le résultat n’est en rien un récit linéaire, bien plutôt un mélange de proses, de poèmes, d’essais et de souvenirs. Quels que soient les efforts que l’Américano-néerlandaise déploie pour traduire son expérience, force lui est de constater que le langage se révèle imparfait. Si la pandémie a créé une parenthèse temporelle, l’attente de l’intervention chirurgicale en ouvre une autre – et pour cette période de transition les mots paraissent tout autant faire défaut.
Un dilemme diabolique
Ce qui semble préoccuper le plus les autrices, c’est bien la question de savoir dans quelle mesure elles peuvent concilier leur métier avec la maternité. Voici quelques années, la Belge Saskia De Coster a publié sur le sujet un roman d’une honnêteté saisissante: Nachtouders (Parents nocturnes, 2019), dans lequel elle met en scène un couple de lesbiennes qui conclut un pacte: le désir d’enfant de Juli sera exaucé à condition que Saskia puisse s’épanouir comme écrivaine.
Leur entente est remise en question lorsqu’elles se rendent au Canada avec leur fils Saul. Là, sur l’île hippie où Karl, le père biologique du garçon, a grandi, la petite famille séjourne pendant plusieurs semaines chez celle de cet homme. Saskia en vient à se poser des questions de plus en plus pressantes. Est-elle une vraie mère si elle n’a ni conçu ni porté Saul? Est-elle à même de s’inculquer ce rôle? Ou peut-elle laisser de côté cette tâche puisque l’écriture répond mieux à ce qu’elle est?
 Saskia De Coster
Saskia De Coster© DR
La protagoniste de Dezelfde maan bataille avec cette même question: «Je m’étais promis de ne jamais avoir d’enfants», se rappelle-t-elle une fois sur son île, loin du monde extérieur. «Je deviendrais romancière. Romancière et mère en même temps, ça n’allait pas, telle était ma conviction. Car ça reviendrait à se contenter de rares bribes de temps entre les tâches ménagères et l’éducation des enfants.»
Bref, écrire exige une concentration de longue haleine, à laquelle la maternité ne laisse que peu de place. Dorien Dijkhuis relève la façon dont certaines de ses consœurs ont abordé la question: Maya Angelou loue une chambre d’hôtel pour travailler sans être dérangée par sa progéniture tandis qu’Alice Munro, assise derrière sa machine à écrire, chasse sa fille de deux ans d’une main tout en tapant de l’autre sur le clavier. La Néerlandaise se demande si une maman auteure n’est pas condamnée à éprouver un sentiment de culpabilité: envers ses enfants quand elle écrit, envers la littérature quand elle s’occupe de ses enfants.
Quelques-unes de ses compatriotes s’attardent elles aussi sur ce dilemme diabolique. Dans Ongevraagd advies (Conseil non sollicité, 2022), son plus récent recueil de poésie, Ester Naomi Perquin évoque les moments où, au cours de ses premières années en tant que maman, elle se réfugiait dans la baignoire pour écrire en toute tranquillité. Dans Moeder en pen (Mère et Stylo, 2023), recueil d’extraits de son journal intime remontant à la période 1979-1983, la romancière Mensje van Keulen se demande régulièrement comment concilier son métier et son état de mère: «Oh! il ne pourrait pas arrêter de pleurer! Même à cette heure-ci! Encore un biberon. […] Je dois travailler à un poème et à mon livre, holà, mon livre? Un jour. Quand viendra-t-il, ce ‘un jour’, si ça continue comme ça?»
Regrets et remords
Alors que certaines songent à ces dilemmes avant même d’être enceintes, d’autres n’y sont confrontées qu’après l’accouchement. Cette dernière situation peut se traduire par des remords -tourments pour lesquels on a créé en néerlandais le substantif spijtmoeder (mère-à-regret), lequel s’est répandu au cours des dernières années. Ces remords sont parfois explicites, mais il arrive aussi assez souvent qu’ils perdurent sous la surface. Prenons par exemple Kleine haperende vluchten (Petits vols heurtés, 2022) de Femke Brockhus, histoire dans laquelle il est question d’une jeune écrivaine qui se volatilise deux semaines seulement après avoir donné naissance à une fille. De la disparue, le père et l’enfant ne reçoivent plus aucun signe de vie.
Quoique: les romans dont elle parlait avec son compagnon, entre autres certains de Virginia Woolf et de Nathaniel Hawthorne, n’offrent-ils pas quelques indices? Dans ces œuvres, les personnages ne disparaissent-ils pas en effet sans motivations réellement claires? La difficulté que la protagoniste éprouvait à mettre au point un texte littéraire nous en dit peut-être plus encore: elle passait des journées entières à trimer devant son ordinateur avant d’effacer tout ce qu’elle avait écrit. Cette lutte avait-elle un rapport avec le fait qu’elle portait un enfant ou son malaise était-il ancré dans sa personnalité? A-t-elle fui la maternité ou la créativité?
Ce qui semble préoccuper le plus les autrices, c’est bien la question de savoir dans quelle mesure elles peuvent concilier leur métier avec la maternité
Pareilles réflexions sont de toutes les époques, ainsi qu’on peut le lire dans Moeders. Heiligen (Mères. Saintes, 2023) de Dieuwertje Mertens. Le roman porte sur Mercedes, une jeune femme qui séjourne en France, dans une maison de vacances, avec son amoureux prénommé Amant, lequel trimbale l’urne contenant les cendres de sa mère. La nuit, Mercedes se rend sur la place du village où se dresse une statue de la Vierge, la mère de toutes les mères. À Marie, elle peut confier la détresse que lui inspire son fils, un adolescent déficient mental, qui a commis un acte impardonnable.
Pour mettre les choses en perspective, la Sainte Vierge sert à la protagoniste l’histoire chaotique de sa propre maternité. Elle aussi s’est parfois demandé ce qu’elle devait faire de son fils. À travers cette narration pleine d’inventivité, Dieuwertje Mertens montre clairement que la vie d’une femme n’est pas toute rose -pensons aux humiliations, aux agressions, aux viols- et qu’il est presque injuste que la maternité vienne s’ajouter aux diverses épreuves de la vie.
Épreuves physiques
À ce sujet, le roman Oersoep (Soupe primordiale, 2023) de Bregje Hofstede prouve que devenir mère n’est pas forcément une partie de plaisir, du moins sur le plan physique. L’histoire commence par la description de l’accouchement, vécu à travers les yeux de la femme en train d’endurer cette souffrance. L’écrivaine l’évoque en un style charnel, les exclamations de douleur s’étirant au point de dégringoler littéralement de certaines pages.
 Bregje Hofstede
Bregje Hofstede© R. Fertinel
La maternité semble toutefois aider la protagoniste à mettre de côté sa nature réservée: désormais, elle suit ses impulsions. Cela donne lieu, entre autres, à d’exubérantes scènes de sexe, à des effusions d’amour ou encore à un trip hallucinatoire sous l’effet de drogues. Devenir mère rapproche apparemment la femme du moi originel -un moi qui, au lieu de dissimuler ses désirs, les embrasse.
Des hommes pourraient-ils décrire de la sorte un accouchement? Le fait que, jusqu’à présent, peu d’entre eux aient relevé ce défi tendrait à montrer que tel n’est pas le cas. Certes, auteur et personnage ne doivent pas nécessairement coïncider, mais une expérience aussi difficile à restituer par le langage réclame d’accorder une attention aux possibilités que le corps et l’esprit de l’auteur(e) peuvent offrir ou, au contraire, ne pas offrir. Il est donc d’autant plus important que des femmes, en particulier des écrivaines, se sentent libres de partager sur le papier leur expérience de la maternité – et toutes les choses intimes qui l’accompagnent.
Un enrichissement pour la littérature
Dans les belles-lettres, la maternité explorée d’un point de vue féminin apporte un éclairage nouveau sur chacune de ses étapes: sur la difficulté de concilier éducation des enfants et production littéraire, sur le préjugé bien ancré selon lequel une femme sans enfant ne serait pas un être humain à part entière, sur le tabou entourant les regrets qui peuvent résulter du fait d’enfanter et sur la façon dont toutes ces phases peuvent se succéder ou se chevaucher.
Écrire au milieu de toutes les situations chaotiques qui entourent la maternité va être ressenti par certaines femmes comme un fardeau supplémentaire et offre à d’autres clarté, indentification et consolation
Pris ensemble, les romans en question offrent une image enrichissante. Alors qu’auparavant les auteurs masculins mettaient surtout en avant les facettes singulières de leurs mères, les autrices montrent pour leur part que la maternité suppose bien plus que le simple fait d’être, avec conviction, une maman: cela va des doutes sur le fait de s’engager sur ce chemin de la vie jusqu’aux regards jetés en arrière en se disant qu’il aurait peut-être mieux valu s’engager sur un autre.
Le style expérimental de la plupart des œuvres mentionnées ci-dessus prouve que toutes ces pensées qui fusionnent ou s’entrechoquent sont loin d’être cohérentes ou abouties. Les écrivaines optent pour un style méandreux, le stream of consciousness, certaines privilégiant, à l’instar de nombre de poètes, des blancs qui soulignent tout ce qui ne peut être exprimé par les mots. C’est là ce que la littérature peut apporter: elle nous permet de prendre conscience qu’écrire au milieu de toutes les situations chaotiques qui entourent la maternité va être ressenti par certaines femmes comme un fardeau supplémentaire et offre à d’autres clarté, identification et consolation.
1. Titre original: Sprakeloos. La traduction française, signée Alain van Crugten, a paru aux éditions de la Différence de Paris en 2011.
2. Titre original: Ik kom terug. La traduction française, signée Daniel Cunin, a paru aux éditions Actes Sud d’Arles en 2020.
Par moments, je veux un enfant: extrait de Jantine Jongebloed
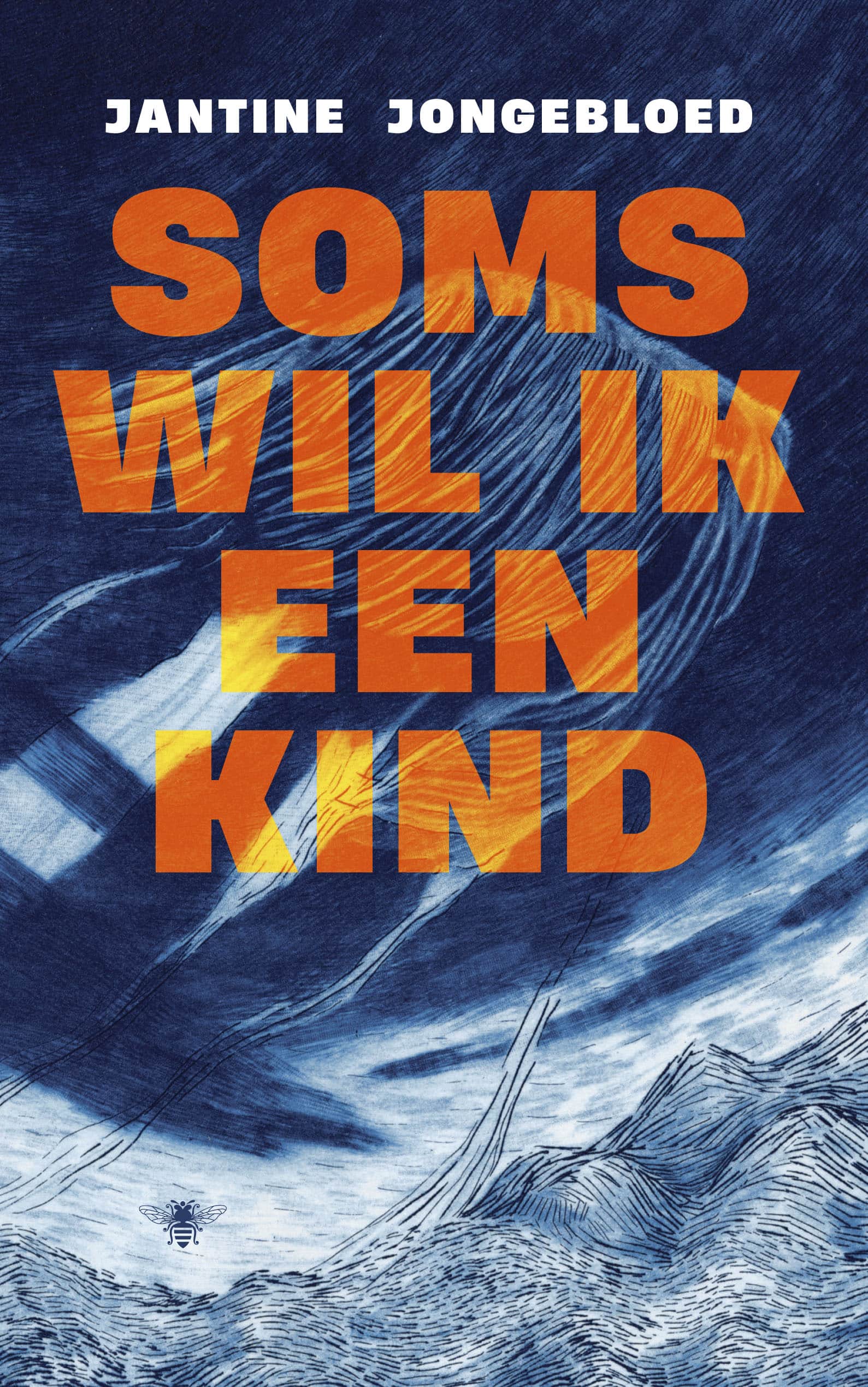
Bien entendu, j’ai grandi avec l’idée que ça se ferait tout seul. Depuis toujours dans ma vie, rien n’est plus normal que de désirer une descendance et de faire des enfants. Durant les grandes vacances, alors que j’avais près de douze ans – peu avant que ne soit libéré le tout premier ovule des quelque 375 à venir -, je me suis appliquée, dans une ferme pédagogique, à plaquer avec l’aide de ma voisine deux lapins peu coopératifs l’un sur l’autre dans l’espoir que ça donne des bébés. Au bout de six semaines exaltantes de laborieux efforts, on s’est rendu compte qu’il s’agissait de deux mâles.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai entendu dire que les enfants, c’est ce qu’il y a de plus précieux. Autour de moi naissait une ribambelle de petits frères, de petites sœurs, de cousins, de cousines… – il s’agit de l’une des idées de base qui m’ont formée. Cela ne tenait encore en rien à la question de savoir si je me reproduirais un jour. Le monde autour de moi se chargerait de fournir des descendants, c’était là une certitude agréable et rassurante.
Je n’ai pas commencé en doutant.
Il y a eu une époque où j’ai désiré un enfant.
Il y a eu une époque où j’étais enceinte.
Ça a capoté.
Par la suite, à un moment donné, j’ai perdu mon aplomb.
Comme je ne souhaite pas trop finir en doutant, je ne peux faire autrement qu’étudier le doute et le comprendre.
Par moments, je veux un enfant. Par moments, est-ce suffisant ?
Extrait de Soms wil ik een kind (Par moments, je veux un enfant), traduit du néerlandais par Daniel Cunin, De Bezige Bij, Amsterdam, 2023.
La poussée d’hormones: extrait de Saskia De Coster
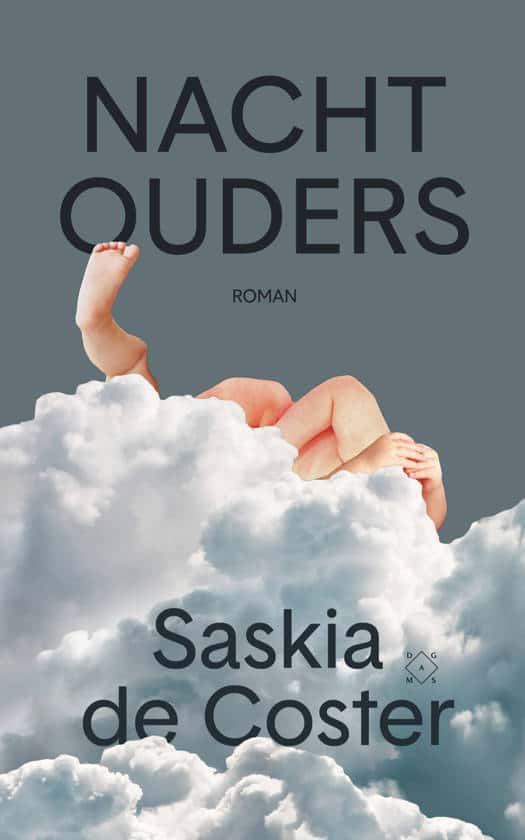
La plupart du temps, elle aussi est parfaitement capable d’ignorer la voix, mais ce soir-là, samedi 14 mai 2013 (la source: son journal intime), à sa propre fête, cette voix sort de la bouche d’une psychologue fraîchement diplômée.
«Tout le monde veut des enfants», dit la psychologue. «Pourquoi tu ne veux pas d’enfant?»
«Mais je veux un enfant», rétorque Saskia.
Un enfant tout mignon en massepain, une peluche à piles du genre Tamagotchi ou un bébé cochon d’Inde qu’on peut enfermer dans une cage avec de l’eau et des graines. Voilà le genre d’enfant qu’elle pourrait envisager d’accueillir chez elle.
Mais un véritable enfant, sans cage, qui arrive sans langes mais doit être changé constamment: non, merci. C’est un brin trop réel pour elle.
Saskia soupçonne une raison biologique derrière le fait de ne pas vouloir d’enfants. Sinon comment l’expliquer autrement? Elle ne la sent pas, cette poussée d’hormones, ce besoin irrépressible, cet appel du corps qui, dans les récits bibliques, parle de lui-même comme d’un arbre fruitier: «Ce corps doit porter du fruit» ou qui fait écrire dans les journaux intimes des vraies femmes: «Ce corps veut faire un enfant tout seul, seul avec lui-même, un spermatozoïde et Google pour les questions pressantes pendant la grossesse.» Les vraies femmes, ses amies, ont des corps qui leur gueulent de façon dictatoriale qu’ils veulent des enfants, et les femmes n’ont qu’à obéir.
Elle n’est ni pour ni contre les enfants. Ses sentiments ne vont même pas jusque-là. Les enfants, les vrais, ceux qui ont dix orteils, mais dont on croit parfois qu’ils n’en ont que huit quand on les compte avec ferveur, les vrais enfants la laissent tout simplement froide. Lorsqu’elle rend visite à une amie lesbienne qui vient d’accoucher d’une petite Emma et qu’on veut lui fourrer de force le paquet entre les bras pour la photo, elle décline gentiment. Imaginez qu’elle laisse tomber le précieux objet, il ne se brisera pas forcément en mille morceaux, mais elle aura perdu une belle amitié. Et, se connaissant, elle sait déjà qu’elle va se mettre à trembler de nervosité et qu’elle ne soutiendra pas la nuque du bébé, lui occasionnant le coup du lapin et l’obligeant pour le restant de sa vie à se promener avec une minerve couleur chair.
Extrait de Nachtouders (Parents nocturnes), traduit du néerlandais par Françoise Antoine, Das Mag, Amsterdam, 2019.
Quelques gouttes: extrait de Bregje Hofstede

C’est drôle que maintenant mes mains sachent quand c’est l’heure d’allaiter. Elles jaugent en un clin d’œil à quel point ils sont lourds et tendus, tâtent l’un, puis l’autre, c’est le néné droit qui est de la revue. Les cercles bleus sont encore là de la fois passée.
Peut-être que la sage-femme a noté ça. Des papiers sont restés sur le lit à côté de moi, elle les a oubliés.
Visite de contrôle à deux semaines. Mère très fatiguée.
Et voilà les notes qu’elle a prises la nuit de l’accouchement.
Heure, comportement. On dirait de l’éthologie.
Il est écrit 4 pattes*, par exemple. Grogne. «Chante». Alterne entre 4 pattes et position latérale. Se redresse, «danse». Ça pousse 1 peu*.
Le «4 pattes» et le «grogne» sont écrits normalement. Seuls les comportements humains sont entre guillemets.
Je me doutais bien que j’en serais réduite à l’état d’animal et, le moment venu, je me fichais, en effet, d’avoir chié sur le divan en poussant. Je l’ai senti en le faisant, puis l’odeur, et j’ai regretté la privation de celui qui aurait trouvé ça grave, mais c’était si peu, si peu.
Et puis, l’instant d’après, constater que votre corps, votre attention et votre âme sont asservis par la créature que vous avez engendrée dans votre fureur.
Essie pleure. J’en suis certaine, mes seins font mal, mais Warre essaie visiblement encore un peu, il a dû recevoir des instructions sévères de la sage-femme. La Mère doit se reposer. La Mère doit se retaper. La Mère ne doit pas sortir du lit avant d’avoir dormi, sinon son lait va se tarir.
C’est vrai, quand j’utilise le tire-lait électrique, il sort péniblement quelques gouttes au bout de dix minutes. Rouges, dans le pire des cas.
Pourquoi tu n’arrêtes tout simplement pas? Oui, pourquoi? Parce que parce que parce que.
Même pas parce qu’on dit que c’est meilleur pour la santé. Ni même parce que les gens me demandent de but en blanc dans la rue si j’allaite. Comme si de donner le biberon équivalait à affamer son bébé. Et quand ils entendent que j’allaite mon enfant, leur visage fond instantanément de béatitude, comme s’ils étaient eux-mêmes à nouveau remplis de bon lait chaud.
Même pas non plus parce que je n’ai pas envie que Warre puisse également être une machine à consoler, mais parce que, parce que.
Je connais plusieurs enfants qui ont très bien grandi sans une goutte de lait maternel, dit ma mère. Et: Tu sais ce qu’on dit dans l’avion, les mères d’abord, sécurisez d’abord votre propre masque à oxygène. Si tu t’effondres, tout s’effondre. Je ne peux rien objecter, parce que j’ai très bien grandi, mais je continue quand même, parce que,
Parce que c’est comme une réparation. Le comblement d’une solitude à laquelle je ne suis pas encore habituée, et elle encore moins.
Je crois que c’est pour ça qu’elle crie ainsi, personne ne crie comme ça parce que son estomac gronde. Son hurlement est trop fort. Il faut l’entendre. C’est presque inconcevable que ça provienne d’elle, elle se contente d’émettre, ça sort des profondeurs mêmes d’où elle a émergé.
Quand elle pleure, c’est comme si ce n’étaient pas mes tympans qui vibraient, mais l’un ou l’autre nerf central. Ça mord, ça déchire, je le sens dans mon corps, une réplique de la toute dernière contraction avec laquelle elle s’est arrachée, a glissé sur le tapis, le long et pâle cordon ombilical lobé qui entrait encore en moi et que j’ai senti tirer, à l’intérieur de mon ventre, quand je l’ai prise dans mes bras. Chaque mouvement qu’elle faisait tirait mon nombril en dedans. À l’envers, nous tenions encore en un seul morceau.







Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.