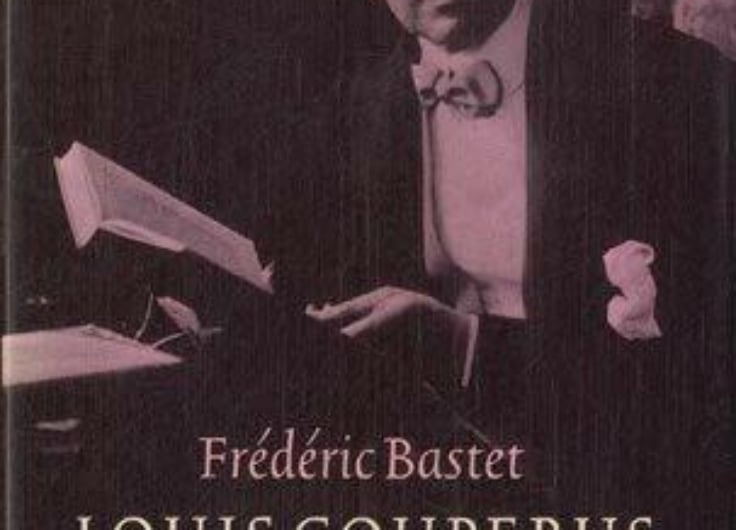L’enjeu de Voyage
au centre de l’Antiquité est de
pénétrer les rites d’un monde mythologique, d’en comprendre la
saveur et le mensonge, la grandeur immémoriale et la corruption
humaine. La narration marie la profondeur et la légèreté, par une
esthétique onctueuse, candide, virtuose et simple.
Né au sein d’une
grande famille de La Haye, en 1863, Louis Couperus vit ses premières
années à Batavia, actuelle Djakarta, en Indonésie. Tradition et
exotisme coexistent ainsi dès son plus jeune âge, jusque dans son
œuvre monumentale, qui occupe cinquante volumes aux Pays-Bas et
recouvre de nombreux champs littéraires, de la poésie à la
nouvelle en passant par le roman, le feuilleton, le conte ou encore
le récit de voyage, faisant de lui l’un des plus grands auteurs de
la littérature de langue néerlandaise.
 Kees Verkade, statue de Louis Couperus (1863-1923) à La Haye
Kees Verkade, statue de Louis Couperus (1863-1923) à La HayeBien que
francophile, ayant notamment passé une dizaine d’années à Nice,
Louis Couperus connaît l’injustice post mortem subie par de
nombreux écrivains étrangers: l’oubli. La publication récente de
Voyage au centre de l’Antiquité aux éditions Martagon,
dans la traduction de Christian Marcipont, intervient donc comme une
réparation, alors même que l’esthétique de ce roman, publié
initialement en 1911, est présentée par l’éditeur comme «très
fin-de-siècle».
L’œuvre est
incontestablement datée, tant sur le plan de la thématique que du
style. Si l’actualisation des mythes – pour les faire entrer dans
nos seules problématiques du jour – est l’une des grandes
tendances contemporaines, le XIXe et la première moitié
du XXe siècle ont opéré un retour à l’antique qui
s’est décliné tant dans la peinture (Ingres, David…) que dans
la littérature (Joséphin Peladan, Anouilh, Giraudoux, Cocteau,
etc.).
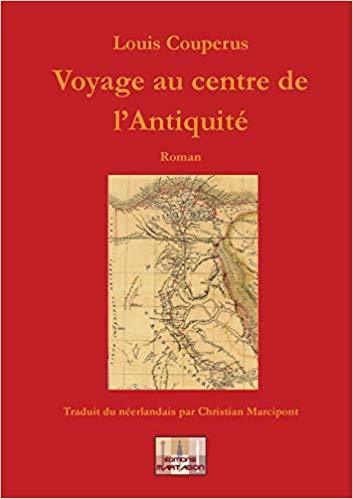
Profondément
influencé par Pétrarque et son amour enflammé pour Laure, Louis
Couperus participe, sur le fond, de cette dynamique, avec des
caractéristiques stylistiques qui lui sont propres, unifiant roman
réaliste et lyrisme élégant. Voyage au centre de l’Antiquité
se présente comme un roman initiatique, dont la quête se révèle
en réalité un prétexte pour parcourir les contrées égyptiennes,
réelles et fantasmées, entre Nil et désert. Le grand voyageur que
fut l’écrivain, qui visita aussi bien l’Allemagne, l’Italie et
l’Angleterre que le Japon, l’Algérie ou encore la Provence,
livrant nombre de comptes rendus sous des formes littéraires
diverses, se plaît à rêver de périples au pays des langues mortes
et des souvenirs vivants.
Voyage au centre
de l’Antiquité, plus précisément en Égypte, préfigure
d’autres récits à venir, tels que Herakles en Grèce et
au-delà (1913), De komedianten dans
la Rome du Ier
siècle (1917) ou encore : Iskander. De roman van
Alexander den Groote (Iskander. Le roman d’Alexandre le Grand)
en Perse et en Inde (1920). Nous y voyons un jeune et beau patricien
romain, Publius Sabinus Lucius, qui quitte la péninsule italienne
pour gagner l’Égypte, afin de consulter les oracles et connaître
la vérité sur la disparition d’Ilia, son esclave et sa
bien-aimée.
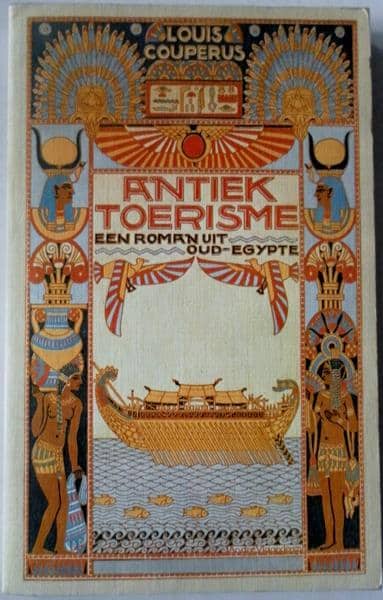
Accompagné d’un
oncle aussi truculent que désargenté, d’un pédagogue affranchi
et avisé, d’un petit esclave libyen fidèle et de la jolie Cora,
esclave douée pour le chant et la danse, qui achèvera de guérir
l’âme de son maître, Lucius vit une aventure tout autant
intérieure qu’extérieure.
Le récit des
souffrances du riche Romain, bien que servi par une élégance
stylistique presque sans failles, a des accents pathétiques, du fait
d’un lyrisme parfois suranné. C’est que Louis Couperus fait de
cette quête le creuset de chacune des rencontres religieuses,
spirituelles et mystiques que proposait en son temps l’Égypte,
pays alors réputé pour garder invisiblement la parole secrète de
la sagesse. L’enjeu est de pénétrer les rites d’un monde
mythologique, d’en comprendre la saveur et le mensonge, la grandeur
immémoriale et la corruption humaine. La narration marie la
profondeur et la légèreté, par une esthétique onctueuse, candide,
virtuose et simple.
Louis Couperus
partage avec Joris-Karl Huysmans, écrivain parisien de quinze ans
son aîné, dont on sait les origines néerlandaises, un goût pour
l’encyclopédisme qui survole l’intrigue et célèbre la beauté
du monde, la grandeur de ses mystères, chrétiens pour le Français
dans En route (1895) et plus généralement dans sa trilogie
de la conversion, ésotériques pour le Néerlandais: la description
minutieuse des cultes rendus aux dieux et aux bêtes est tantôt
somptueuse, tantôt amusante.
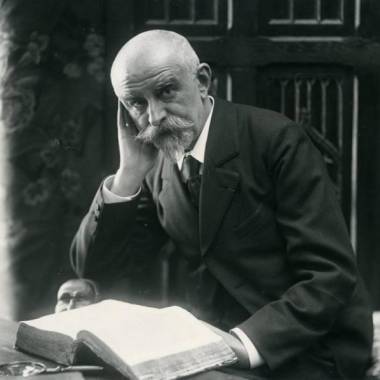 Joris-Karl Huysmans (1848-1907).
Joris-Karl Huysmans (1848-1907).«Chats et éperviers, moutons et loups, cynocéphales et zébus, aigles et lions, chèvres, boucs araignées : pas une bête qui ne fît l’objet d’un culte dans tels ou tels ville ou village […]. Aussi l’oncle Catullus déclara-t-il qu’il était las de se voir contraint d’admirer tous ces animaux sacrés, d’autant plus qu’Apis le taurillon et Such le crocodile étaient les seuls à présenter quelque intérêt pour les spectateurs.»
Là où Huysmans ne se permet que de rares excursions humoristiques, Louis Couperus joue subtilement sur la clarté d’une Antiquité à la sagesse fantasmée et sur la dérision devant les excès qui conduisent les hommes à se précipiter aux pieds et aux pattes de la première divinité proclamée. En cela encore, l’écrivain néerlandais est incontestablement de son temps.