«In het jaar van de rode os» de Marije Langelaar: les fentes par lesquelles nos vies disparaissent lentement
In het jaar van de rode os (L’année du bœuf rouge), le premier roman de Marije Langelaar, est un bref triptyque où rêve et réalité s’étendent doucement l’un à côté de l’autre, en quête d’une parfaite symbiose.
Ces dernières années, la Zélandaise Marije Langelaar (1978) s’est patiemment forgé une belle réputation en tant que poétesse. Ses recueils De rivier als vlakte (2003), De schuur in (2009) et Vonkt (2017) ont remporté plusieurs prix et nominations, tant en Flandre qu’aux Pays-Bas.
 Marije Langelaar
Marije Langelaar© Ivonne Zijp
Dans In het jaar van de rode os, paru juste avant l’été, transparaît clairement la voix de la poétesse. Dans ce roman truffé de métaphores originales et pleines de fantaisie, rien n’y est ce qu’il paraît au départ, et tout ou presque y semble possible. En outre, pour peu qu’on lise avec assez d’attention, tout et tout le monde y apparaît lié. Tout cela a pour avantage de permettre au lecteur de laisser sa propre imagination courir à sa guise au fil des histoires racontées par Marije Langelaar.
Le roman se présente comme un triptyque. Dans la première partie, intitulée «Land» (Terre), nous faisons la connaissance d’une jeune fille, bien que son âge ne soit pas spécifié. Timide, elle préfère demeurer invisible. Durant la grossesse de sa mère, elle est emmenée chez sa grand-mère, où elle a l’occasion de vivre des aventures avec un petit voisin qu’elle trouve très sympathique. Heureusement, car il n’y a pas grand-chose à faire, du reste, dans la ferme de grand-mère: «La journée se partageait entre la préparation des repas et la digestion de ceux-ci.»
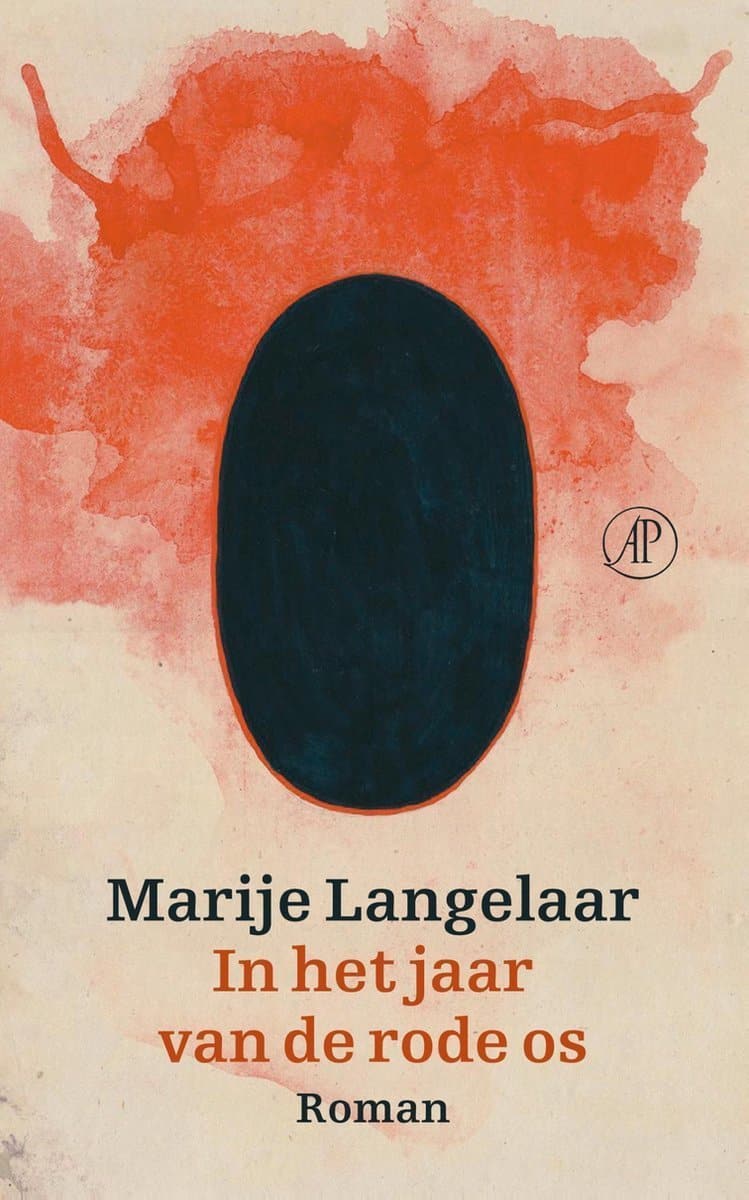
La deuxième partie, «Lasso», est une histoire dystopique, dans laquelle le monde est tombé en proie à la PPG, Privation Partielle de Gravité, faisant que les gens et les objets se mettent parfois à voler. Par moments, la PPG est si forte qu’hommes, animaux, voitures et vélos disparaissent en flammes dans l’atmosphère. Comme le Covid-19, la PPG divise le monde en croyants et non-croyants: certains estiment que la PPG est la revanche de la planète sur l’humanité et que l’humain n’a plus le droit de résister. Ils s’habillent de blanc et se laissent engloutir de bonne grâce par le noir cosmos lors d’une nouvelle attaque de PPG.
Enfin, la troisième et dernière partie consiste en un roman épistolaire. Quelque part dans un pays hispanophone, une femme écrit des lettres à un condor, grand vautour vivant principalement dans la cordillère des Andes. Totalement envoûtée par ce condor, elle est également persuadée d’en avoir été un elle-même, d’avoir elle aussi possédé ces ailes puissantes, des ailes qu’elle aspire à retrouver, des ailes qui lui donneraient la liberté…
C’est un roman qui demande à être lu comme un recueil de poésie, avec une attention méticuleuse à chaque détail et à la langue ludique, riche et originale de Langelaar
Bien que ce ne soit nulle part explicité, les trois parties du livre sont bel et bien liées entre elles. L’on peut ainsi présumer que les trois narratrices sont une seule et même femme, non seulement par l’évidence de cette possibilité, mais plus encore parce que les histoires se font écho par de subtils renvois. Dans chacune d’elles apparaît un bébé, ce qui n’est pas toujours une nouvelle heureuse ou attendrissante. Il s’agit toujours aussi de faire attention aux fentes, par lesquelles la vie menace de disparaître, lentement mais sûrement. Il y a aussi du sable qui tourbillonne, des bœufs bien sûr, et d’autres signes de la nature. On reconnaît pleinement la poétesse de Vonkt, un recueil recelant également des éléments mystiques et spirituels. Dans la troisième partie surtout, le rêve et la réalité se fondent jusqu’à se confondre.
Ainsi Marije Langelaar joue-t-elle divinement avec ses propres histoires et le lecteur. C’est un livre à lire calmement, devant l’âtre crépitant, et dont il faut savourer chaque mot, au risque de passer à côté de trésors. C’est un roman qui demande à être lu comme un recueil de poésie, avec une attention méticuleuse à chaque détail et à la langue ludique, riche et originale de Marije Langelaar. Peu importe que vous manquiez l’une ou l’autre référence ou ne remarquiez pas tous les liens entre les trois parties. En fin de compte, il y a suffisamment de clés pour comprendre que tout et tout le monde est lié, que l’on vit (et ne peut vivre) séparément les uns des autres.
Il va sans dire que cela ne met pas toujours d’humeur très gaie. Mais il y a toujours moyen de se consoler. Comme l’écrit Marije Langelaar: «Je trouvais rassurant, lorsque tout et tout le monde vous déçoit, qu’il reste toujours la nuit noire et les arbres. Et le vent. Le sable qui tourbillonne. On n’a besoin de rien d’autre.»
Extraits de «In het jaar van de rode os» traduits par Françoise Antoine
Premier extrait
I
Le crépuscule enlevait toutes les couleurs pour les reposer ailleurs. Je contemplais l’herbe haute qui poussait à environ un mètre de la véranda et s’agitait comme si des animaux invisibles s’y battaient.
Je buvais mon lait en observant aussi quelques insectes qui filaient comme l’éclair en quête d’un abri.
Je versai par terre le fond de ma tasse et le fin filet se répandit en faisant de petites éclaboussures blanchâtres. Sur le plancher incliné, quelques gouttes disparurent dans des fentes. Le sol absorba goulûment.
Il n’y avait pas que du lait, mais aussi des brindilles, des punaises, des bestioles, et toujours la pluie qui disparaissaient dans le trou sombre en dessous de la maison. Je pressentais d’ailleurs l’existence d’autres fentes plus grandes, qui englobaient tout et dans lesquelles la vie des malades et des vieillards finissait par s’écouler avant que la mort ne délie les langues avec du venin.
Du bout de mes sneakers, j’essuyai les minuscules taches demeurées en surface, laissant une traînée, et rentrai.
Ma mère était à table, assise devant un grand puzzle de la cathédrale Saint-Martin, elle m’attira contre elle, me caressa les cheveux, puis me dit qu’elle était enceinte.
Mon père buvait du café.
Second extrait
Mi amado cóndor
Condor, mon bien-aimé, sauvage fleur noire dans le ciel, dans les arbres, je t’écris.
C’est toi qui es là, mais un jour j’étais toi. Moi aussi, j’avais des plumes noires, ruisselantes comme une chute d’eau noire sur une tête lisse, je plongeais dans le ciel, m’arrimais au vent et volais dans le soir rougeoyant, planant au gré du vent. J’étais vraiment un oiseau magnifique. Majestueux! J’avais beaucoup de frères et sœurs en dessous de moi, j’avais beaucoup d’enfants. De la nourriture à satiété.
Il a dû se passer quelque chose, peut-être ai-je vu un être humain, plongé dans ses occupations, avec son bateau, sa cabine, serrant un autre humain dans ses bras, peut-être ai-je vu des enfants courir et jouer dans la vaste plaine, ou entre les tiges se balançant au vent, et peut-être alors le désir a-t-il jailli de ressentir ces choses-là, moi aussi. D’être un marcheur sur la terre, doté de deux jambes permettant de courir ou danser, de nager.
Ce bref désir a dû suffire à attirer mon âme, aussi curieuse qu’une petite souris, dans l’enveloppe charnelle d’un être humain, à choisir le moment où un homme et une femme s’accouplaient, à saisir l’instant de la conception, et c’est là qu’a commencé mon développement dans ce fœtus de petit d’homme. Oh! on se sent si gauche, privé d’ailes royales. J’avais des douleurs de croissance, poussais des cris inaudibles dans le ventre de ma mère humaine. Au rythme de son battement de cœur, je m’imaginais disparaître. Comme sur une grande roue, je serais sortie de son corps en tournant, c’est possible, condor, mon cher condor, tu le sais.













