Sauver la mère ou l’enfant? Dilemmes médicaux au XIXe siècle
Durant la crise du coronavirus, le scénario catastrophe d’une saturation des départements des soins intensifs belges a été avancé. Heureusement, il ne s’est pas concrétisé, mais cette crise a mis en lumière un dilemme auquel peuvent être confrontés tous les médecins: qui choisir lorsque la situation ne permet pas de traiter tous les patients? De tels dilemmes ne sont pas nouveaux. Au XIXe siècle, il n’était pas rare que les médecins doivent choisir entre la vie d’une femme ou celle de son enfant à naître.
Au XIXe siècle, les médecins étaient régulièrement confrontés à la nécessité de faire un choix entre la vie de la mère ou celle de son enfant à naître en cas d’accouchement difficile. Ce qui a toutefois changé depuis lors, c’est la manière dont de telles décisions sont prises. Les comités d’éthique qui établissent aujourd’hui des directives pour les soignants des unités de soins intensifs n’existaient pas encore au XIXe siècle. Chaque médecin n’avait dès lors pas d’autre choix que de s’en remettre à son propre jugement.
Liberté professionnelle et liberté idéologique
Dans la Belgique du XIXe siècle, les médecins jouissaient d’une grande part de liberté. Le gouvernement libéral de l’époque ne se préoccupait guère de la réglementation de la médecine, et encore moins de la mise en place de principes éthiques. Une fois leur diplôme en poche, les médecins pouvaient sans problème définir leurs propres critères pour le traitement de leurs patients. Il était tout de même attendu qu’ils se tiennent informés, par le biais de publications scientifiques, des nouvelles méthodes thérapeutiques et des recommandations des autorités scientifiques, mais les dérogations à cette règle n’étaient pas considérées comme problématiques, pourvu que chaque médecin puisse justifier ses propres choix de traitement. Le désir d’agir en toute liberté était alors plus puissant que l’aspiration à l’uniformisation des pratiques.
En matière d’éthique, liberté professionnelle rimait également avec liberté idéologique. En 1852, par exemple, s’est tenu un débat de première importance à l’Académie royale de médecine de Belgique (Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België) au sujet de la justification ou non d’un avortement médical «préventif» chez des femmes enceintes au bassin trop étroit. Sans une interruption de grossesse, ces femmes avaient de fortes chances de mourir lors de l’accouchement. Selon les membres catholiques de l’Académie, l’avortement médical constituait une violation du commandement «tu ne tueras point». Ils se positionnaient donc en faveur de la césarienne, une opération qui pouvait en théorie sauver les deux vies, mais qui en pratique se révélait souvent fatale pour la mère. Les médecins libéraux, quant à eux, avaient plutôt tendance à donner priorité à la vie de la mère. Après une année d’intenses débats, les membres de l’Académie ne sont pas parvenus à formuler un avis d’application générale sur l’avortement. L’Académie a donc conclu qu’il était du ressort de chaque médecin de décider, en fonction de la situation, s’il pratiquait un avortement médical ou non.
 Six diagrammes d'avortements à différents étapes, dessins réalisés par Campbell (référence 17112i)
Six diagrammes d'avortements à différents étapes, dessins réalisés par Campbell (référence 17112i)© Wellcome collection
Un poids sur la conscience
Pour les membres de l’Académie, l’issue de tels dilemmes relevait donc d’une question de conscience de la part du médecin traitant. De même, dans la plupart des facultés de médecine, les étudiants étaient fortement encouragés à écouter la voix de leur conscience. Seuls les médecins diplômés de l’Université catholique de Louvain avaient reçu des directives claires en matière d’éthique durant leurs cours d’obstétrique: l’avortement médical ou toute autre opération mettant directement en danger le fœtus n’étaient selon les professeurs pas compatibles avec la foi catholique.
 Doctorants en médecine à l'Université catholique de Louvain à la fin du XIXe siècle
Doctorants en médecine à l'Université catholique de Louvain à la fin du XIXe siècle© archives universitaires de KULeuven
Le fait que les médecins devaient agir en accord avec leur conscience impliquait qu’ils ne devaient pas pratiquer d’interventions qu’ils désapprouvaient. Selon le cadre hiérarchique du XIXe siècle, les médecins étaient les mieux placés pour prendre une décision concernant le traitement de leurs patients. Les futures mères et leur entourage ne jouaient donc qu’un rôle mineur dans le processus de décision. En cas de situation de vie ou de mort, comme lors d’un accouchement difficile, il était usuel de demander l’accord de la patiente avant de pratiquer une intervention. Mais cette autorisation n’était pas synonyme de liberté de choix: même si les femmes pouvaient en théorie refuser l’intervention proposée par leur médecin, elles n’étaient souvent pas en état de proposer une solution alternative.

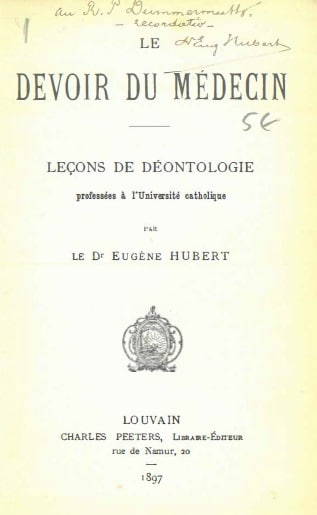 Eugène Hubert (1835-1905), professeur d'obstétrique à l’Université catholique de Louvain et auteur de l'ouvrage Le Devoir du médecin (1892)
Eugène Hubert (1835-1905), professeur d'obstétrique à l’Université catholique de Louvain et auteur de l'ouvrage Le Devoir du médecin (1892)Cette responsabilité individuelle du médecin lors d’une prise de décision difficile présentait toutefois un sérieux revers. En 1892, par exemple, Eugène Hubert, professeur en obstétrique à l’Université catholique de Louvain, est revenu sur un accouchement particulièrement difficile durant sa carrière qui n’avait cessé de le hanter. Celui-ci s’était terminé de la pire manière possible, car Hubert avait refusé de sacrifier la vie du fœtus pour sauver celle de la mère. Puisque la patiente, qui avait un bassin vraiment très étroit, avait refusé de subir une césarienne, ce médecin profondément croyant avait décidé d’attendre la mort du fœtus. Ce n’est qu’après le décès qu’il jugea raisonnable d’effectuer une opération destructrice qui permettrait au fœtus de passer plus facilement le long du canal génital. Les heures et les jours passèrent, et rien ne put sauver la mère, qui est finalement décédée peu de temps après son enfant à naître. Depuis lors, Hubert était rongé par le remords: «Ce fait m’a obsédé longtemps comme le souvenir d’un cauchemar.»
Manuels d’éthique
Vers le début du XXe siècle, des manuels d’éthique à destination des médecins amenés à faire des choix difficiles ont commencé à voir le jour. À l’Université catholique de Louvain, les questions d’éthique commencèrent à former une discipline à part entière de déontologie médicale. Durant les premières décennies du XXe siècle, d’autres facultés de médecine suivirent le mouvement. Le développement d’un positionnement éthique et déontologique est également devenu l’une des missions principales de l’Ordre des médecins, fondé en 1937. Cette tendance s’est renforcée dans la deuxième moitié du siècle, qui a assisté à la création de chaires d’éthique médicale dans les universités, et de comités d’éthique dans les hôpitaux.
Ignaas Devisch: «Vous ne pouvez pas et ne devez pas, en tant que médecin, décider de cela tout seul»
Aujourd’hui, les médecins en soins intensifs savent à quoi se référer en cas de scénario catastrophe. Outre les orientations du service public fédéral Santé Publique, les comités d’éthique des organisations hospitalières ont également formulé leurs propres recommandations dans les cas où un choix est à faire entre plusieurs patients sérieusement affectés par le coronavirus. Pour décider si la priorité doit être donnée aux patients ayant de meilleures chances de survie, ou aux patients ayant le plus d’années de vie devant eux, les médecins peuvent et doivent se référer à une série de critères préétablis. Ces directives éthiques ont été mises en place en tenant compte de l’impact psychologique que ces prises de décision difficiles peuvent avoir sur les médecins. La nouvelle devise médicale peut se résumer à cette déclaration d’Ignaas Devisch, professeur de philosophie médicale à l’université de Gand: «Vous ne pouvez pas et ne devez pas, en tant que médecin, décider de cela tout seul.»






