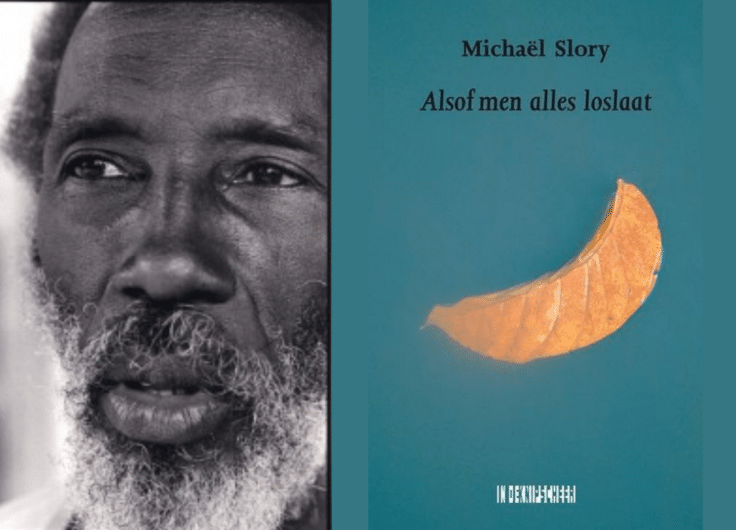«Ma Rochelle passée. Bienvenue El Dorado» de Cynthia McLeod
Née en 1936, Cynthia McLeod est la fille d’un instituteur devenu, en 1975, le premier président du Suriname. Ses romans historiques et ses études sur le passé de son pays lui valent une grande réputation. Plusieurs de ses œuvres sont traduites en anglais et en allemand.
Vendu à 150 000 exemplaires, son premier roman Hoe duur was de suiker? (Le Prix du sucre) a été porté à l’écran. Dans les trois phrases qui suivent, basées sur le nom de plantages fondés par des colons français, Cynthia McLeod exprime les sentiments mêlés de bien des Surinamiens vis-à-vis du passé: «Mon pays! va comme je te pousse, à la bonheure. Maintenant vous n’êtes pas mon gagné pain et nous avons souvent court d’argent et une vide bouteille. Mais malgré ça, vous êtes mon plaisir, mon trésor, mon bijou.»
Le roman Ma Rochelle passée. Welkom El Dorado (1996) entraîne le lecteur au Suriname, pays natal de son autrice, Cynthia McLeod, à travers une saga qui couvre les années 1845-1894. C’est plus ou moins au milieu de cette période que l’on a assisté, dans cette Guyane sous domination néerlandaise, à la fin de l’esclavage et, par suite, au déclin de certains grands domaines.
 Cynthia McLeod
Cynthia McLeodPassionnante fresque historique, Ma Rochelle passée conte le destin de la famille Couderc et d’une poignée de leurs esclaves, essentiellement des femmes. Beaucoup de planteurs établis dans cette région du monde étaient des Français, la plupart originaires de La Rochelle ou de Bergerac. En raison de leur foi réformée, ils s’étaient vus contraints de quitter leur pays après 1685 et la révocation de l’édit de Nantes; réfugiés en Hollande, ils avaient bientôt été invités à aller faire prospérer la lointaine colonie. Certains rêvaient d’un El Dorado, leur imagination étant aiguillonnée par les rumeurs relatives à la présence d’or dans la forêt amazonienne ou par la perspective de s’enrichir en exploitant du sucre, du tabac, du coton… Les premiers huguenots arrivèrent de l’autre côté de l’Atlantique dès la fin de XVIIe siècle. Nombre de Surinamiens portent aujourd’hui un patronyme issu de ces colons.
Contexte historique, liens sociaux dans la capitale Paramaribo déterminés essentiellement par la pigmentation de la peau, fils de planteur qui épouse une ancienne esclave, fille de planteur qui a un enfant adultérin avec un métis, homme blanc qui entretient une maîtresse de couleur, gouverneur cruel, gouverneur aimé de tous, main-d’œuvre arrivée de gré ou de force des Indes britanniques pour remplacer les Noirs libérés du joug de l’esclavage, ascension sociale d’anciens esclaves, dissensions linguistiques (le sranan[tongo] ou créole était devenu la langue maternelle des esclaves auxquels on interdisait de parler néerlandais tout comme on leur interdisait de porter des chaussures)… autant d’ingrédients qui, agencés en une mosaïque témoignant d’une profonde connaissance historique, nous restituent, sans concession en même temps qu’avec beaucoup de nuances, des pans de vie où alternent atrocités, drames, tragiques secrets de famille, mais aussi tendresse, lueurs d’espoir ou encore découverte de la musique et de la littérature. On garde à jamais en mémoire l’image de l’inattendu Eldorado sur laquelle se referme cette histoire à la fois lointaine et si proche.
Sylvia et Esthelle, dont il est question dans le passage traduit ci-dessous, sont deux esclaves au service de la famille Couderc. Comme elles s’apprêtent à quitter pour toujours leur région natale, celle où se dresse la demeure du planteur décédé, de sa veuve, missi Constance (le terme missi désignant la maîtresse de maison), et de leur descendance, celle où se situe le village des esclaves, celle où, à la naissance des deux femmes, a été enterré leur cordon ombilical, elles sont autorisées à célébrer une fête rituelle avec leurs semblables. À Paramaribo les attend une existence qu’elles ne peuvent soupçonner…
La danse des esclaves
Il était plus ou moins dix heures en cette soirée où brillait la pleine lune; le fleuve Commewijne s’apparentait à une étendue argentée. Sur la rive, un groupe de femmes formait un demi-cercle. En leur milieu, Sylvia et Esthelle ne portaient qu’un court pagne noué autour de leur taille, qui tombait à mi-cuisses. Dans une longue jupe blanche, une prêtresse se tenait près d’elles, une branche à la main; plusieurs calebasses étaient posées à ses pieds. Les femmes se mirent à chanter, battant en cadence des mains et remuant le corps sur le rythme du chant. La prêtresse commença par se frapper à quelques reprises à coups de branche sur le dos, les bras, les cuisses et les jambes puis elle passa à Sylvia et à Esthelle. Ensuite, elle s’empara d’un bâton et entreprit de touiller dans les calebasses. Elle ne cessait de pousser des cris, les autres reprenaient la phrase qu’elle venait de prononcer et l’entonnaient à quelques reprises. Puis la prêtresse prit une calebasse dans laquelle elle versa un soupçon de ce que contenaient les autres et une cruche. Elle avala une gorgée du liquide, pria Sylvia et Esthelle de faire de même. À pas lents, la femme entra alors dans l’eau, suivie des deux autres, le groupe, toujours en chantant, les imita mais sans avancer très loin, l’eau ne leur arrivant tout au plus qu’aux chevilles. La prêtresse aspergea Sylvia et Esthelle, les autres firent de même. Le chant se prolongea pendant que toutes ressortaient du fleuve.

Alors que la prêtresse retournait au village des esclaves, les autres lui emboîtèrent le pas en dansant. Une fois sur la place, on enroula autour des hanches de Sylvia et d’Esthelle une sorte de sarong bigarré, on leur passa des colliers autour du cou et, autour des bras et des chevilles, des «menottes», autrement dit des bracelets. Entre-temps, il était minuit. Reprenant chants et danses, le groupe entier se dirigea vers le kapokier, l’arbre qui dépasse tous les autres de plusieurs têtes et auquel le nègre rend un culte. L’ensemble du village, femmes et hommes, attendait là; habillé comme un chef de tribu africaine, le grand prêtre se tenait prêt à lancer la danse qu’on appelle watramama. Dans une main, un couteau à lame courbe. Dans la deuxième, une tige de sangrafoe dont il tapota toutes les personnes réunies autour de l’arbre. Chacune, à ce contact, criait: Tata jepi wi, Dieu viens-nous en aide!
Toute la cérémonie s’accompagnait de chants et de battements des mains. Quand elle fut terminée, quelques hommes prirent place derrière leurs tam-tams. Ils se mirent à battre de leurs tambours, tout le monde chantait, le rythme ne cessa de s’accélérer. On dansa jusqu’au matin. Par moments, à cause de la fatigue, un esclave perdait presque connaissance, mais il s’écartait pour se remettre avant de reprendre de plus belle. La danse se prolongea jusqu’au lever du soleil. Puis tout le monde regagna sa hutte pour s’y reposer. Il va de soi que, ce jour-là, tous étaient dispensés de travailler.
En réalité, la fête se poursuivit quatre nuits durant. Au milieu de la journée, Sylvia et Esthelle, de même que d’autres esclaves affectées à des tâches ménagères dans la demeure de la famille Couderc, y retournaient pour préparer les repas et assumer leurs besognes habituelles.
La semaine de danse passée, Sylvia et d’autres aidèrent à faire les malles; quelques jours plus tard, missi Constance, Danielle, sa fille retardée, et quelques esclaves embarquèrent en direction de Paramaribo. Elles quittaient le plantage Ma Rochelle pour toujours.