Lorsqu’elle a choisi de quitter sa Pologne natale à l’âge de dix-neuf ans, Aleksandra Lun a opté pour la très méditerranéenne Barcelone. Ce n’est que douze années plus tard que Bruxelles s’est imposée à elle. Cette ville complexe et imprévisible, qui ne demande rien à personne, a été le déclencheur de son écriture.
J’ai du mal à l’écrire.
Stromae
Voilà plusieurs semaines que je peine à écrire ce texte. Il doit porter sur Bruxelles et sa relation avec mon écriture. Le retard est attribuable en partie à mon chien, qui me dérange sans cesse. Chaque fois que j’arrive à un point fort du processus, il exige de sortir se vider la vessie. Si ce que j’écris est particulièrement mauvais, il se vide aussi les intestins. Mon chien a un problème avec les livres et les librairies. Moi, j’ai un problème avec la non-fiction. Je me sens à l’aise avec le roman: j’aime inventer des mondes, créer des personnages, observer la manière dont une histoire surgit peu à peu d’un nombre limité d’éléments que je ne maîtrise pas. Je suis née dans un système totalitaire et les systèmes totalitaires sont une excellente école de fiction. Même maintenant, à quarante-deux ans, j’ai une compréhension toute limitée de la réalité. C’est un handicap qui me coûte les yeux de la tête. Je verse des pénalités pour des factures en souffrance, je paie des taux d’intérêt élevés, j’achète des billets d’avion chers. Je le dis sans vouloir me donner des airs d’artiste alternative: bien malgré moi, j’ai échoué à en devenir une. Au contraire, j’aimerais parfois mener une vie plus réaliste et plus économique. Vivre dans la fiction coûte très cher.
Vivre à Bruxelles ne coûte pas beaucoup moins cher. Certains Parisiens croient que si, mais ils croient aussi que leur ville a été libérée en 1944 par ses habitants et non par les soldats alliés qui ont volé à leur secours. Autrement dit, je ne suis pas la seule: à un degré ou à un autre, nous vivons tous dans la fiction. Selon une étude scientifique récente, cinquante pour cent de notre passé, malgré les souvenirs que nous en conservons, ne s’est jamais produit. Nous inventons des histoires et nous finissons par y croire: tous nous sommes en train d’écrire le grand roman de notre vie. Et même si chacune des histoires que nous nous racontons semble traiter d’une thématique différente, toutes portent sur la même chose: notre place dans le monde.

© Lexi Lauwers / Pexels
Je suis partie à la recherche de ma place dans le monde à dix-neuf ans, sans argent et sans autre projet que celui de m’éloigner de mon pays natal, la Pologne, où je m’étais toujours sentie étrangère et où de surcroît on mangeait très mal. Le passage de l’Europe de l’Est à la Méditerranée a été enivrant, comme quitter une pièce obscure pour une terrasse ensoleillée où, en prime, on servait des calamars en sauce. En ces temps post-olympiques, Barcelone sentait les livres fraîchement imprimés, les ascenseurs surannés de l’Eixample et la crème solaire bon marché. Cette Méditerranée de la fin des années 1990, méprisée par le Nord de l’Europe qui y voyait une destination touristique à rabais, m’a donné une éducation universitaire et sentimentale en plus du premier lieu où je me suis sentie chez moi: la langue espagnole.
Mais si Barcelone m’a donné la langue, c’est Bruxelles qui m’a donné l’écriture.
Tout comme un roman peut manquer de vie, mon écriture manquait d’un élément déclencheur. Bruxelles a été ce déclencheur
Avant d’y arriver, à trente et un ans, je n’avais jamais rien écrit. En Pologne et en Espagne, j’avais beaucoup lu, beaucoup vécu et beaucoup réfléchi: en somme, j’avais tout ce dont a besoin un écrivain prétentieux. Mais tout comme un roman peut manquer de vie, mon écriture manquait d’un élément déclencheur. Bruxelles a été ce déclencheur.
Je ne savais rien de la ville. Les études de philologie belge n’existent pas et mon unique point de référence sur la capitale de la Belgique était une photo de ma mère à Mini-Europe, le parc de miniatures du quartier bruxellois de Laeken. Après la chute du mur de Berlin, ma mère et une voisine avaient réservé un des premiers voyages organisés à l’Ouest. Sur une photo prise dans le parc, elles posent, géantes, devant une tour de Pise à peine plus haute qu’elles. Elles affichent toutes deux le sourire timide des premiers touristes d’Europe de l’Est, animaux libérés d’un zoo qui ont envahi les toilettes gratuites des autoroutes occidentales du début des années 1990.
Cette photo était si troublante que je n’aurais jamais choisi Bruxelles comme lieu de vie. Ce fut plutôt Bruxelles qui m’a choisie. Mais il vaudrait mieux parler d’un enlèvement. Bruxelles m’a enlevée, m’a tout enlevé. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la case départ. Ma nouvelle identité méditerranéenne, que j’avais mis tant d’années à construire, a disparu en un clin d’œil. Soudain, je n’étais de nulle part. Je n’étais personne.
J’aurais pu me suicider, mais à cause de ma compréhension limitée de la réalité, j’étais convaincue que la banque saisissait l’argent de quiconque mourait sans testament. Ma situation économique avait toujours été précaire, mais j’avais de petites économies amassées à grand-peine: l’idée que ces salauds allaient mettre la main dessus m’énervait beaucoup. Pendant quelques jours, j’ai songé à prendre rendez-vous chez un notaire, mais ma phobie administrative a fini par l’emporter sur mon envie de mourir. J’ai abandonné l’idée du suicide et, pour le plus grand malheur de mes lecteurs, j’ai commencé à écrire mon premier roman.
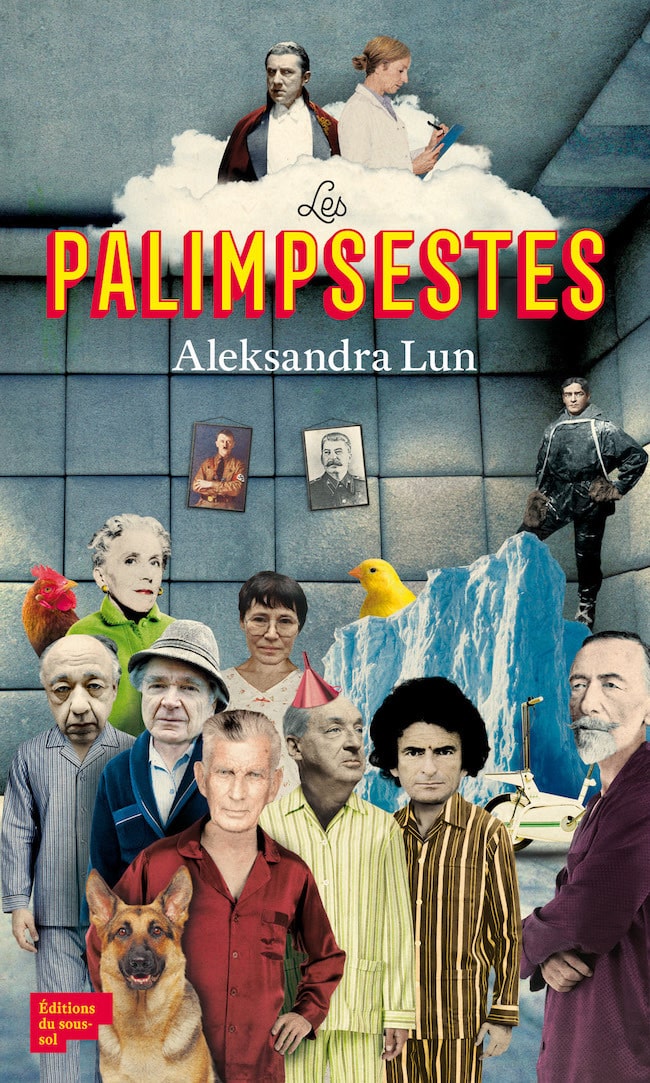
Depuis, douze ans ont passé et j’ai écrit à Bruxelles deux romans de plus et une grande variété d’autres formes de prose. Mails d’amour, WhatsApp de rupture, listes d’achats, longs échanges avec des médecins étrangers, réclamations présentées à des compagnies d’assurances et des milliers de pages de traductions sur le développement durable et les engrais chimiques. J’ai également rempli des dizaines de cahiers d’écolier, que j’achète au Carrefour, de mes peurs, aspirations, angoisses, euphories et frustrations, agrémentées à l’occasion de quelque fantasme sexuel. J’ai écrit, dans des appartements loués, des cafés huppés et des gares de train, la première page de livres que je ne terminerai jamais. Je ne les terminerai jamais parce que, pour y parvenir, je devrais être la personne qui a écrit ces premières pages. Et je ne suis plus cette personne.
Connaissant d’expérience la complexité d’une vie divisée en plusieurs existences, Bruxelles se penche vers l’inconnu avec grâce
De toutes les villes que j’ai connues, c’est Bruxelles qui permet le mieux de changer. Plongée dans ses propres conflits et contradictions, elle n’a ni le temps ni l’envie d’imposer une trajectoire cohérente à qui que ce soit. Connaissant d’expérience la complexité d’une vie divisée en plusieurs existences, elle se penche vers l’inconnu avec grâce. Bon an mal an, elle suit son propre chemin de changement. L’été, elle fait advenir l’obscurité avec lenteur, rythme très différent de celui de la Méditerranée, où la nuit tombe d’un seul coup sans vous donner le temps de vous y préparer. En automne, elle s’enveloppe d’une brume resplendissante qui sent les feuilles mortes et la mer du Nord. En hiver, elle nous recouvre d’un manteau sombre, sous lequel l’unique lumière provient des étincelles lancées par les câbles du tramway et des colliers lumineux des chiens. Au printemps, elle déploie sur nous son ciel immense: s’élevant au-dessus des maisons basses, le ciel est la vingtième commune de Bruxelles.
Une ville, comme une œuvre littéraire, est un registre de changements.
Quand on me demande pourquoi j’écris, j’évite de répondre directement. C’est tellement facile de tomber dans la grandiloquence et, au bout du compte, dans le pathétique. De dire que l’écriture me sauve, qu’elle sauve le monde ou à la rigueur une espèce de larve préhistorique de la forêt amazonienne. Woody Allen a dit en entrevue qu’il fait des films pour s’occuper les mains. Moi, je crois que j’écris parce que je ne fume pas. J’aimerais beaucoup fumer: avoir quelque chose à faire de mon corps quand je manque d’assurance, m’asseoir à une terrasse et regarder dans le vide, cigarette à la main, comme un personnage de la Nouvelle Vague. Si je fumais, je n’aurais peut-être jamais commencé à écrire et alors je ne serais pas en train de lutter avec ce texte de non-fiction au lieu de profiter de toutes les promotions de mon supermarché.
J’ai du mal à écrire ce texte parce que quand j’écris de la non-fiction j’ai l’impression de mentir. C’est quand j’écris de la fiction que j’ai le sentiment de dire la vérité. La vérité sur mes personnages et aussi sur moi-même. C’est dans la fiction que je peux consigner toutes les transformations que je vis. Explorer toutes les versions antérieures de moi-même. Connaître toutes les Aleksandra qui ont vécu ma vie.

© J Torres / Unsplash
Ainsi, l’absence de nicotine n’est peut-être pas la seule raison: si j’écris, c’est peut-être aussi parce que je suis en train de changer. Et si je change, c’est peut-être parce que j’écris. L’écriture est une forme d’amour et, comme l’amour, elle impose des changements irréversibles dans ma vie. Elle m’oblige à casser des vitres, à défoncer des portes, à creuser des tunnels à mains nues (le tout sans fumer une seule cigarette). Elle m’oblige à tracer une nouvelle carte, à inventer une nouvelle architecture de moi-même.
Ces dernières semaines, je relis mon œuvre littéraire la plus importante –mes cahiers du Carrefour, qui documentent mes douze années à Bruxelles. En les parcourant, je me demande combien de ces peurs, de ces angoisses et de ces frustrations ont été et sont encore une tentative de raconter ma vie comme une histoire cohérente. Une histoire aux chapitres clairement délimités. Une histoire avec un début et une fin libres de désordre et de complications. Une histoire à la trame logique, sans détours ni allers-retours.
Je ne juge pas Bruxelles pour ses soudaines chutes de grêle ni pour son habitude de me laisser en rade à dix heures du soir, sans un seul autobus en vue. Elle ne me juge pas si je sors encore plus stressée qu’avant de mon cours de réduction du stress ou si je mets un an à faire un petit appel à ma banque
Je lis la vie que décrivent mes cahiers du Carrefour et elle me fait penser à Bruxelles. Complexe et imprévisible, avec des travaux qui commencent et n’en finissent plus, des lignes de métro qui n’aboutissent pas, des impasses, des projets abandonnés et des édifices vides ayant jadis abrité un hôtel de luxe. Mais aussi des places toutes nouvelles et des rues qui changent de direction, des édifices rénovés et des couches de peinture fraîche. Tout ce qui fait qu’une ville ou une personne n’est pas une histoire classée, n’est ni un musée en plein air ni un cadavre. Ces changements qui rendent vivantes les villes et les personnes.
Au cours de nos douze années de vie commune, Bruxelles et moi sommes tombées amoureuses comme seules peuvent le faire deux personnes ayant d’abord conclu un mariage de raison. Sans autre expectative de départ qu’une relation civilisée, nous sommes devenues des amantes passionnées qui, de surcroît, s’entendent très bien. Je ne juge pas Bruxelles pour ses soudaines chutes de grêle ni pour son habitude de me laisser en rade à dix heures du soir, sans un seul autobus en vue. Elle ne me juge pas si je sors encore plus stressée qu’avant de mon cours de réduction du stress ou si je mets un an à faire un petit appel à ma banque. Comme toutes les villes et toutes les personnes, Bruxelles et moi sommes deux êtres vivants en constante transformation. En compagnie des autres villes et des autres personnes, nous traçons la carte d’un monde qui continue d’évoluer. Parce que nous sommes tous une multitude de fictions sans trame logique ni fin bien définie. Une multitude qui cherche sa place dans le monde et ne peut aspirer à le faire qu’avec l’élégance des larves préhistoriques de la forêt amazonienne.







