«Niemand keek omhoog»: Sommes-nous maître de notre vie?
Evelien Vos (° 1987) évoque la vie apparemment banale de Lucy, protagoniste de Niemand keek omhoog (Personne ne leva les yeux). Mais finalement la question se pose: de quelle façon et comment sommes-nous maître de notre vie?
«Ma mère»
Quand elle était petite, ma mère ressemblait à Anne Frank. Elle avait le même nez et les mêmes yeux sombres, qui dégageaient sur les photos quelque chose d’à la fois mélancolique et joyeux. Elle devait se rendre à l’école à vélo, douze kilomètres aller et douze au retour, parce qu’elle était la seule du village à pouvoir suivre l’enseignement secondaire. Elle y obtenait des notes correctes, parce qu’elle était intelligente, mais aussi par peur de l’échec. Son père était le pasteur du village, un homme sévère, très différent du mien.
Un jour, après quelques verres de vin, elle me raconta que son père l’avait giflée lors du passage de la fanfare du village parce qu’elle était sortie de la maison en dansant et en agitant les mains au-dessus de la tête.
«Tiens-toi bien», l’avait-il grondée.
Pendant un an, ma grand-mère avait été contralto à l’Orchestre de chambre des Pays-Bas, mais mon grand-père l’avait obligée à arrêter parce qu’elle était trop peu souvent à la maison.
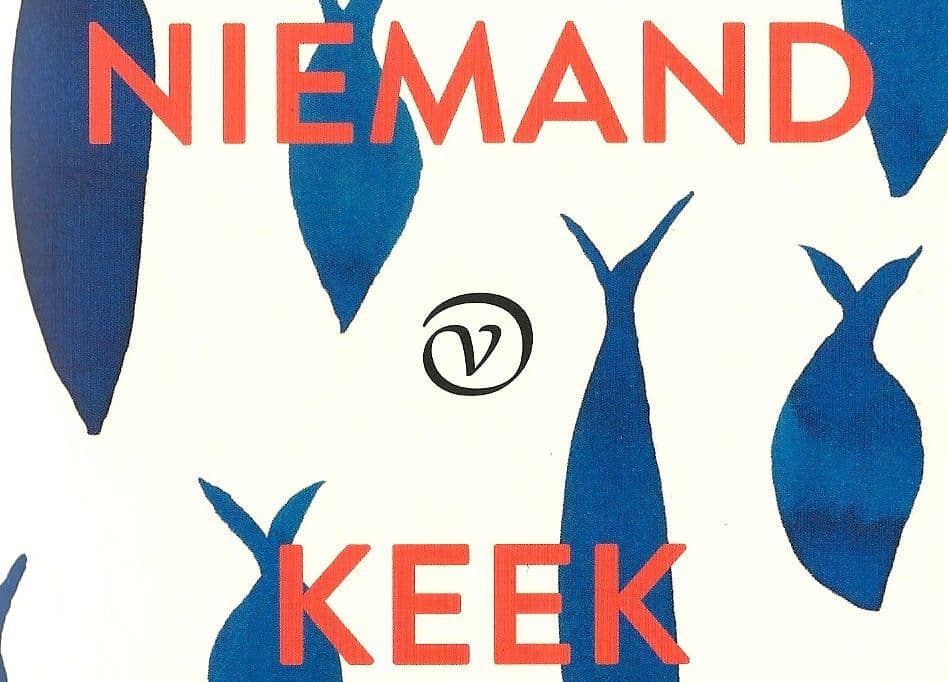
Petite, j’observais souvent ma mère : assise dans le jardin, le visage tourné vers le soleil, se mettant du rouge à lèvres dans le reflet de la remise avant d’enfourcher nos vélos pour aller à l’école, ou riant si fort au téléphone avec une amie que je voyais ses plombages. Les pères de mes copines étaient plus drôles quand elle était dans les parages.
«Je suis la femme la plus heureuse du monde», soupirait-elle parfois. « J’ai une maison, un mari, un fils et une fille en bonne santé. » Quand elle disait cela, on avait l’impression que ce n’était pas à nous, mais à elle-même qu’elle s’adressait. Comme si elle devait se convaincre.
Elle réduisait au minimum les choses qu’elle n’aimait pas faire. Par exemple, elle n’aimait pas cuisiner, si bien qu’une fois par semaine, elle pelait quelques kilos de pommes de terre, que nous mangions ensuite pendant cinq jours d’affilée. Elle ne travaillait pas, mais elle n’aimait pas non plus faire du thé quand nous rentrions de l’école, ni poser des questions. Elle était toujours soit occupée avec la haie soit partie à la bibliothèque, où elle faisait la lecture aux femmes analphabètes, pour se rendre utile à la société.
Au dîner, mon père nous posait parfois des questions, à mon frère et à moi, sur l’école, le football ou la danse, et ma mère faisait alors semblant d’écouter, mais son attention était en réalité concentrée sur autre chose. Sur les voisins qui passaient à vélo, sur la façon dont mon frère et moi tenions nos couverts, sur les titres du NRC Handelsblad ou encore sur le bruit que faisait mon père en mangeant sa salade iceberg. Elle était capable de se fâcher tous les soirs à ce sujet. Mon père se contentait de soupirer et continuait vaillamment à manger, tandis que j’essayais d’entendre ce que ma mère voulait dire exactement.
«Caresser des chiens»
Nous nous installâmes en terrasse, dans le soleil hivernal, sur une place pentue couverte de gravier, où les enfants soulèvent des nuages de poussière quand ils jouent au football. Dario mit ses lunettes de soleil, une paire dont on aurait dit qu’il l’avait reçue avec un pack de six bouteilles de coca, et dit qu’il avait tapé « se faire tromper » dans Google.
«Je vais passer par différentes phases», dit-il.
Un homme corpulent d’une soixantaine d’années sortit et prit notre commande. «Sans doute», répondis-je.
Je posai ma main un instant sur la sienne, regrettant de ne pas pouvoir voir ses yeux.
Nous nous tûmes un moment. Un lévrier noir passa devant notre table et s’arrêta. Dario le caressa avec attention sur le museau et sous la tête, tandis que de l’autre main il lui fermait la gueule et la secouait un peu de gauche à droite. Le chien remuait la queue et Dario semblait seul au monde avec lui.
De l’autre côté de la place, une femme rousse siffla et le lévrier courut vers elle. «Depuis si longtemps, c’est quand même différent», dit Dario.
Il posa ses lunettes de soleil sur la table et me regarda.
«Et puis avec toi, j’ai toujours su que ça se reproduirait. Je ne pouvais pas mourir sans recoucher avec toi.
– C’est la même chose, non?» dis-je.
Il secoua la tête.
«Non, je ne trouve pas »
Je relevai un peu mon col et le regardai, assis sur sa chaise, les mains dans les poches. Peut-être serrait-il un caillou ou une châtaigne.
«C’est quoi alors, une relation, selon toi?», demandai-je.
Il me regarda du coin de l’œil, sans bouger la tête.
«Non, sérieusement, dis-je. J’ai quelques idées, mais je ne sais pas comment c’est, donc ça ne compte pas.
– Je ne sais pas non plus, dit-il. Celle-ci en était une, mais il existe une infinité de combinaisons imaginables.
– Mais quand est-ce bon?», poursuivis-je.
Il haussa les épaules.
«Quand tu sens que c’est bon.
– Eh bien, je n’ai jamais eu ça», dis-je.
Le serveur reparut et regarda son papier, comme s’il vérifiait à qui étaient destinées les boissons, alors que nous étions comme toujours les seuls clients. Les gens normaux travaillent pendant la journée.












