«Treurwil» de Rik Van Puymbroeck: passages poignants d’une vie mélancolique
Par trois fois déjà, Rik Van Puymbroeck, journaliste flamand, a été couronné maître conteur par la Fondation néerlandaise pour le journalisme narratif. Aujourd’hui, ce talent narratif s’est trouvé un nouveau chemin d’expression dans un premier roman: Treurwil.
En introduction de cet article, un petit avertissement s’impose. J’ai connu personnellement Rik Van Puymbroeck au printemps 1998. Les journaux pour lesquels nous travaillions venaient de fusionner et le rédacteur en chef de l’époque trouva judicieux de confier la direction des rédactions sportives fusionnées à deux jeunots: moi-même, qui étais à la fin de la vingtaine, et Rik, tout frais trentenaire.
Alors que je n’avais pratiquement pas d’expérience en matière de journalisme sportif, Rik était quant à lui un reporter cycliste estimé. Il avait le souci du détail, de la compassion pour les exclus du podium et une plume sensible capable de relater les exploits de la vie cycliste, comme ses côtés les plus sombres. Dans les deux rédactions, les journalistes de chaque bord cassaient volontiers du sucre sur le dos de leurs nouveaux collègues –qui n’y connaissaient rien évidemment–, mais le talent de Rik se hissait naturellement au-dessus de ces guéguerres infantiles; jamais il ne vint à l’esprit de quiconque de mettre en doute ses compétences.
Dans ses relations interpersonnelles, Rik était plutôt taciturne, voire distant. Comme s’il économisait ses mots pour ses articles. Peut-être d’ailleurs était-il déjà occupé à les rédiger dans sa tête lorsqu’il regardait une fois de plus dans le vague d’un air rêveur. Les interventions de Rik étaient toujours pertinentes, mais elles étaient rares, et tout aussi rarement il révélait tant soit peu sur lui-même. Je ne me souviens pas non plus qu’il ait jamais haussé la voix; le timbre de Rik était calme et chaleureux.
À l’époque, je pensais que, comme moi, il avait un peu trop écouté The Smiths ou The Triffids, un jeune homme un peu mélancolique, ayant le goût de la beauté et du mot bien choisi. À la fin de cet été-là, il a perdu son frère, de quelques années son aîné, ce qui a encore renforcé le silence.
Un quart de siècle plus tard, j’apprends que c’était davantage qu’une simple mélancolie romantique et qu’il y avait une tragédie plus ancienne sous-jacente. À 17 ans, Rik avait vu son meilleur ami mourir dans ses bras après un accident avec sa nouvelle mobylette. C’est le jour où il est né –ainsi commence Treurwil– et ce jour, il ne l’a jamais oublié. Ce n’est que bien plus tard qu’il a compris qu’il s’agissait d’un événement profondément traumatisant qui le marquerait pour le restant de sa vie.
Dans de courts récits souvent interconnectés, Van Puymbroeck cherche à autoriser la douleur et à créer un espace où pleurer pleinement la perte
Ce n’est pas explicite, mais c’est peut-être aussi en ce jour maudit du 31 octobre que l’écrivain Rik Van Puymbroeck est né. L’homme qui tente de guérir par la pensée et par les mots ce qui ne peut l’être. Le temps guérit toutes les blessures, affirme le proverbe, et lorsque les gens perdent un être cher, nous leur souhaitons de la force et leur conseillons de se souvenir des beaux moments et de les chérir. Jamais nous ne leur souhaitons de chérir leur peine justifiée, jamais nous ne leur disons que le manque qu’ils ressentent est légitime.
Or c’est exactement de cela que parle Treurwil: d’admettre le chagrin et le manque. Dans de courts récits souvent interconnectés, Rik Van Puymbroeck cherche à autoriser la douleur et à créer un espace où pleurer pleinement la perte. Non pas dans une sorte de misanthropie ou de dépression, mais comme une forme de consolation, presque de cadeau. Ce qui ne l’empêche pas de décrire les sentiments d’un homme qui, après un tel drame, ne sera plus jamais capable d’insouciance, un homme qui doute. C’est lorsqu’il parle de ses filles que cet aspect affleure le plus douloureusement. Il y a beaucoup à lire entre les lignes de ce livre, mais l’amour paternel et les inquiétudes qu’il entraîne sont, eux, très nettement évoqués.
Treurwil n’est pas un roman traditionnel: il n’y a pratiquement pas de suspense, il n’y a même pas d’histoire à raconter. Rik Van Puymbroeck explore son propre chagrin à travers des souvenirs personnels, parfois difficiles à retrouver, ou encore au moyen d’un vieux carnet de notes. Films, musiques, cimetières et autres paysages (urbains), romans et poèmes défilent également. Ce sont là des passages d’une existence un peu mélancolique, d’une vie de lutte, qui connaît également de vrais beaux moments. Car dans la beauté il puise du réconfort, la beauté permet de pleurer. Et pleurer peut faire partie de la vie. Non, ça doit faire partie de la vie.
le roman montre qu’il est possible de vivre l’affliction, sans pour autant être englouti par la morosité
L’auteur entremêle ainsi la mort de son jeune ami avec celles de son frère aîné, Tom, décédé dans un accident de voiture, et de sa mère. Contrairement aux deux hommes, la mère étant malade depuis un certain temps, sa mort n’était pas une surprise. Elle occupe néanmoins une place importante dans le livre, ne serait-ce que parce que Rik Van Puymbroeck ne se rend compte qu’après la mort de sa mère qu’il ne l’a pas assez connue. Il réfléchit alors à la relation avec son père, un homme aussi renfermé que lui. «Je suis issu d’une lignée d’hommes taciturnes», note Van Puymbroeck. Il avoue cependant son goût pour ce silence. Ce n’est pas un hasard si une maison située dans un hameau presque abandonné en Auvergne tient un rôle aussi important dans ce roman; une maison animée seulement par les livres et un saule pleureur planté par ses soins.
En racontant ces souvenirs et les réflexions d’un homme à la tête emplie de chagrin, Rik Van Puymbroeck parvient toutefois à éviter le sentimentalisme. Il ne cherche pas à faire couler les larmes, bien au contraire. Treurwil montre qu’il est possible de vivre l’affliction, sans pour autant être englouti par la morosité. Le tout dans une langue magistrale, qui nous console par sa beauté. Une langue sans foisonnement, parcimonieuse même par moments. Rik Van Puymbroeck indique avoir élagué son texte, comme un fermier fauche son champ jusqu’à ce qu’il ne reste plus que du chaume. Du chaume en guise de ponctuation. «J’aime employer les tirets, les virgules, les deux-points et les points d’interrogation. Ils permettent de s’arrêter.» S’arrêter sur les choses qui comptent vraiment. Comme l’amour et son revers, le deuil.
Rik Van Puymbroeck, Treurwil, De Bezige Bij, Amsterdam, 2023.
Treurwil
La première lumière du printemps tombe sur le mur de la pièce où je suis installé pour écrire. Le matin, quand le soleil brille déjà plus fort, il dessine sur le placard de la cuisine l’ombre des bouleaux encore nus du jardin. Un instant plus tôt, au lit, j’avais déjà vu le soleil, qui formait une bande de lumière au-dessus du radiateur de ma chambre. Dans le salon, cette lumière effectue un parcours sur les murs. Le soleil éclaire d’abord le thermostat, puis la lumière glisse lentement. Elle rase le buffet où sont rangés les albums de photos et sur lequel se trouve un tourne-disque, la pochette du disque qui y est encore –aujourd’hui et depuis longtemps Coltrane–, quelques livres favoris sur le couvercle du tourne-disque, elle passe sur des photos, une lampe, une Renault 4 miniature, encore des livres, un petit cadre de la photographe Katrien De Blauwer, sur le téléviseur. Je sais que la lumière se déplace et disparaît. Chaque matin, j’ai de la peine à dire adieu à cette lumière. Je ne peux dire adieu à rien.
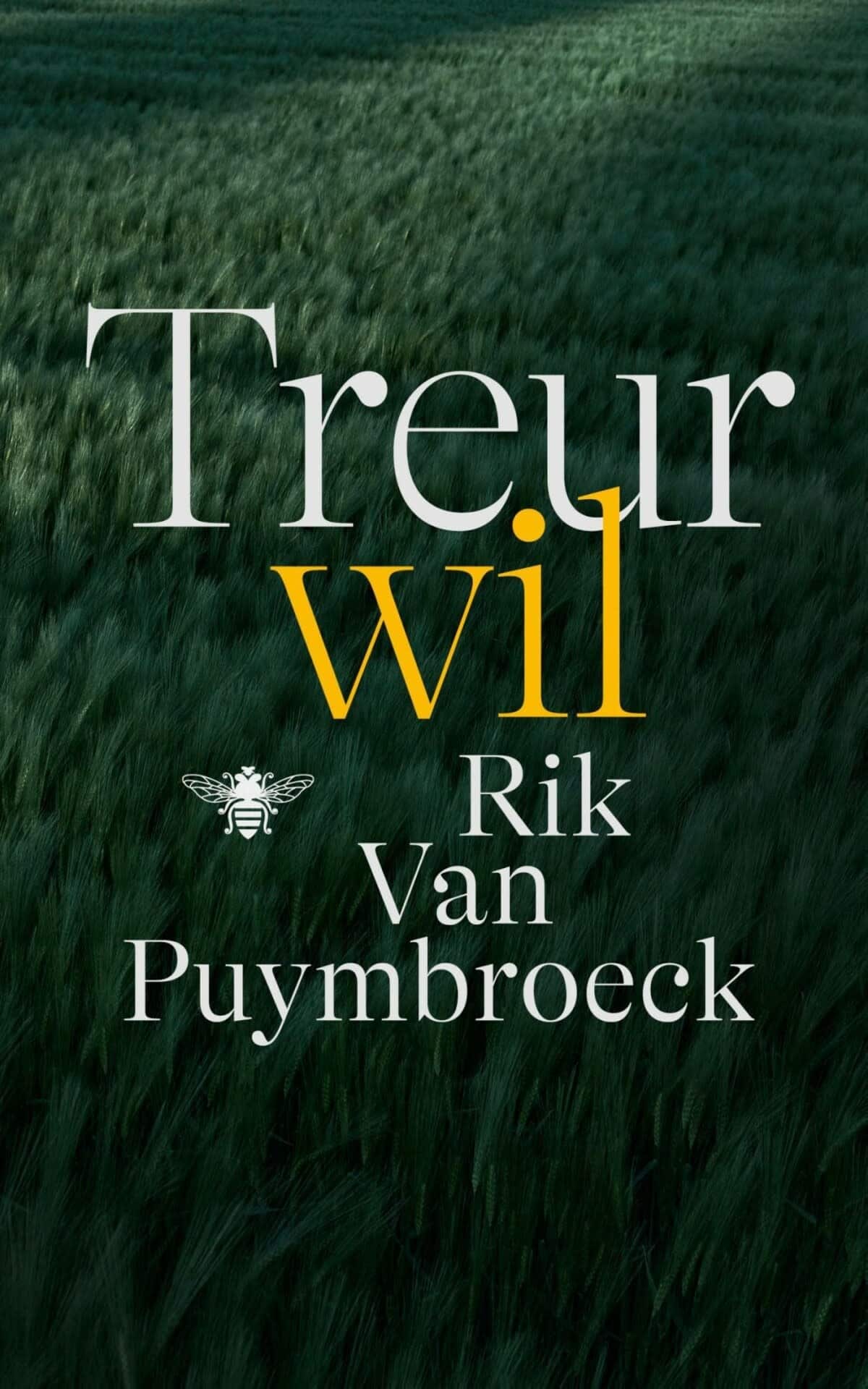
«Les seules lettres que je voudrais vraiment écrire sont celles que j’adresserais à mes morts», notait Elias Canetti, mais qu’est-ce que j’écrirais? Longtemps, je me suis demandé ce que j’aurais voulu dire si j’avais su qu’un ami et un frère allaient mourir. Si l’adieu s’était annoncé. On se trompe soi-même avec cette question. Leur mort était survenue brutalement, après le choc et les obligations d’usage –larmes, enterrement– le temps vous est offert de réfléchir à cette question. De trouver les mots, d’ordonner les pensées, de rassembler les souvenirs, les excuses, les remerciements, les dernières offrandes. Mais la mort est unique. L’inopinée n’est pas comparable à la longue et lente agonie. Canetti serait prêt à ne rien faire d’autre qu’écrire des lettres à ses morts.
Et si j’avais pu écrire ces lettres avant l’adieu? Les semaines qui ont précédé la mort d’Erik, ce sujet me tourmentait. Il ne pouvait ou ne voulait pas voir venir la mort. La vidéo ne donne pas de réponse et le mot n’apparaît dans aucun des SMS et des messages WhatsApp que je gardais. Parfois, il ne se sentait pas bien, était très fatigué, s’en excusait presque.
Nous nous sommes vus une dernière fois. Il avait une houppe, portait des lunettes, nous avons parlé de beaucoup de choses, cette soirée-là, mais pas de ça. Comment il se sentait, mais pas ce à quoi il pensait, ni comment il voyait l’avenir ou ce qui devait encore être dit. Mon seul geste d’adieu est passé inaperçu: j’ai demandé à sa femme de prendre quelques photos.
J’ai failli écrire: «de prendre encore quelques photos» et dans ce mot «encore» réside le fatalisme. Six lettres qui auraient pu me trahir ce soir-là. Encore. Un adverbe doté d’effets secondaires, mais pas un médicament, au contraire, «encore» est le cocktail empoisonné qui aurait pu lui ôter son dernier espoir. Il n’envisageait «encore» que dans son autre acception: laisse-nous rêver encore longtemps, faire encore de nombreux projets.









